Rebecca Enonchong : «Les startups africaines qui réussiront à structurer le social e-commerce gagneront»

Dans la sphère tech africaine, Rebecca Enonchong multiplie les casquettes. Fondatrice d’AppsTech, un spécialiste de logiciels de gestion d’entreprise actif dans une cinquantaine de pays ; présidente d’Afrilabs, un réseau panafricain composé de plus de 150 centres d'innovation dans 40 pays ; et membre du Conseil consultatif de l’identité numérique des Nations unies pour l’Afrique -entre autres- elle est une fervente promotrice de la technologie en Afrique et milite pour un meilleur financement des startups sur le Continent à travers l’African Business Angels Network qu’elle a cofondé. Elle en parle dans cet entretien en revenant notamment sur l’enjeu de l’économie numérique pour l’émergence du Continent et donne aux startuppers quelques pistes de réussite sur le marché africain de l’e-commerce.
La technologie apparaît clairement comme un enjeu pour l'avenir. Comment l'Afrique peut-elle capitaliser sur l'économie numérique pour davantage émerger ?
Tout d'abord, je pense que nous avons un problème avec les gouvernements en Afrique, car ils ne sont pas les premiers utilisateurs du numérique. Pour un grand nombre d'entre eux, encourager l'économie numérique se limite à acheter des ordinateurs et y installer Microsoft. Alors qu'à ce stade, le numérique n'a même pas encore commencé. Il faut donc une transformation technologique profonde qui commence au niveau de institutions gouvernementales. Dans les ministères, combien de fois n'avons-nous pas obtenu des cartes visites de ministres ou de très hauts fonctionnaires faisant mention d'adresses email Yahoo ou Gmail. Il existe pourtant des outils de mailing professionnels. C'est fondamental. On ne peut pas utiliser Yahoo comme adresse email professionnelle et parler d'économie numérique.
On ne peut pas non plus couper internet. Nos dirigeants tiennent le discours de ceux qui soutiennent l'économie numérique, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, certains d'entre eux coupent Internet ou limitent les réseaux sociaux. En agissant ainsi, ils montrent qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'économie numérique. Ils ne se rendent pas compte du coût de ce manque à gagner pour l'économie, mais aussi en termes de perception du pays face au reste du monde. C'est ce genre de double langage de nos dirigeants qui montre qu'ils n'ont pas vraiment compris ce que c'est que l'économie numérique.
Dans un tel contexte, quels sont les risques que l'Afrique rate le virage de la quatrième révolution industrielle ?
Notre continent a raté les trois premières révolutions industrielles. Si on ne prend pas des mesures extrêmes pour non seulement rattraper notre retard, mais essayer d'aller de l'avant, il y a malheureusement de fortes chances qu'on rate la quatrième révolution industrielle. J'insiste là-dessus, mais c'est uniquement parce que ce sont eux qui donnent le ton. Nos dirigeants devraient faire un réel effort d'adoption des politiques qui propulsent nos pays. Certains pays font plus d'efforts que d'autres. Les politiques élaborées sont souvent positives. Même s'il peut parfois y avoir de la maladresse dans leur exécution, il y a au moins cette volonté d'aller de l'avant.
Ce serait dommage que nous rations ce train, surtout au vu du sens de l'innovation et l'esprit d'entreprise qui caractérise la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Mais c'est fort probable, si on ne prend pas des mesures extrêmes. Aujourd'hui, il nous faut rattraper notre retard. C'est une course. Si dans une course, on utilise un vélo, tandis que nos concurrents sont en Ferrari, on peut aller aussi vite que l'on veut, on ne pourra jamais les rattraper. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de courir en vélo, alors que nous avons besoin de la Ferrari. Alors, allons-nous doter nos économies de Ferrari, c'est-à-dire investir massivement dans le numérique comme facteur de développement ou allons-nous en rester à nos vélos ? C'est la question qui se pose désormais.
Les startups africaines trouvent encore des difficultés à lever des fonds. Vous avez commencé à en financer quelques-unes. Est-ce votre façon de susciter l'intérêt des investisseurs du Continent ?
J'ai toujours dit : «Let put our money where our mouth is». C'est une expression anglaise pour dire -littéralement- qu'il faut mettre l'argent là où il y a la bouche. On parle beaucoup de soutenir les jeunes entrepreneurs. Nous avons commencé avec les tech hub en Afrique en 2009, cela a pris actuellement une ampleur et une dimension extraordinaires. On les encadre et on les forme, notamment dans l'élaboration de business plan pour faire un réel business. On leur apprend comment communiquer avec les investisseurs. Mais jusqu'ici, ce sont toujours les étrangers qui y investissent le plus. Les investisseurs locaux n'ont pas vraiment fait d'efforts. Ce qui a créé un déséquilibre, car même ceux qui ont les moyens d'investir ne savaient pas comment cela se passait. Je pense que dans le monde des startups, l'investissement est différent que dans l'immobilier ou tout autre secteur «traditionnel».
Lorsque nous avons fait ce constat, s'est posés la question sur la manière avec laquelle nous pouvions donner aux investisseurs africains les outils et les connaissances pour pouvoir réellement accompagner les startups tout en gagnant de l'argent derrière. C'est pour cela que nous avons créé African Business Angel Network qui est un réseau de business angels. Le but n'est pas d'investir, mais de pousser et de promouvoir l'investissement en Afrique par les Africains et donner les moyens et les outils aux investisseurs pour le faire. Nous organisons donc des masterclass, des bootcamps pour les investisseurs, nous soutenons la structuration des business angels en créant des réseaux de business angels dans des pays différents. Juste cette année, un certain nombre de réseaux ont été créés avec l'aide de Evan, surtout en Afrique francophone. Donc c'est réellement important.
Ce qui n'est pas important en revanche, c'est d'avoir de grands moyens. Car si on attend cela, on va attendra très longtemps. Et malheureusement, nos riches hommes et femmes d'affaires africains sont dans le physique et ont du mal à prendre une partie de leur richesse pour investir dans les startups. Mais je pense que plus on aura des success stories dans l'univers des startups, plus cela éveillera l'intérêt des hommes et femmes d'affaires du Continent. Cela prendra un peu de temps, mais le succès de certains business angels qui auront gagné beaucoup d'argent en investissant dans des startups créatrices de multimillionnaires et milliardaires de demain boostera également la communauté des investisseurs. Pour emprunter les mots de l'avocate américaine Star Jones, «les bonnes intentions intéressent quelques personnes, mais l'argent intéresse tout le monde».
Vous avez été l'un des leaders de la tech africaine à vigoureusement critiquer l'africanité de Jumia. Selon vous, qu'appelle-t-on startup africaine ?
Je vais commencer par évoquer le cas de Jumia, parce qu'il est particulier. C'est la filiale d'un grand groupe européen. C'est comme nous dire que Bouygues décide d'ouvrir des filiales dans plusieurs pays d'Afrique et les qualifie d'entreprises africaines parce qu'il y met 20 millions de dollars, embauche du personnel et créer des marques différentes. C'est exactement ce qu'est Jumia. L'entreprise n'a ni commencé en Afrique, ni été établie par des Africains. C'est une société allemande, Rocket Internet, qui est dans ce business. Cette société créée des marques et des filiales dans le monde entier. Ils ont décidé de développer ces mêmes marques sur le sol africain. Ce n'était pas des marques particulières à l'Afrique, ce sont des marques lancées en Asie, en Amérique latine et en Afrique dans la même période. Et ils ont mis les moyens pour lancer ces startups.
Donc les personnes qui ont développé Jumia sur le Continent ont été embauchées, même si certains ont eu le titre de co-fondateur, ce n'est qu'un titre. On peut aller sur le site de Rocket Internet aujourd'hui et postuler pour un job de co-fondateur d'une de leur filiale dans un pays. C'est leur modèle et c'est assez ridicule pour moi qu'on compare Jumia à une startup africaine. Ils n'ont jamais levé de fonds à partir de l'Afrique. Ils ont levé des fonds à partir de Berlin. Leur premier bureau Afrique était à Paris. Ils ont commencé en 2012 en Afrique et ils ont consolidé toutes les marques différentes qu'ils avaient sous le nom de Jumia en 2016 et ensuite ils ont déménagé le bureau d'Africa Internet Group pour s'installer à Dubaï. Aucune décision du groupe n'est prise sur le Continent. Et il n'y a aucun Africain au niveau Groupe de Jumia. Dans certains pays, ils ont des country managers qui sont africains, mais qui rendent compte à Dubaï et à Berlin. Personne ne rend compte au Nigeria. C'est pour cela que quand les gens disent que Jumia a commencé au Nigeria, je dis non, ce n'est pas vrai.
Et cette appropriation du terme startup africaine est une injure. Ils n'ont aucun ingénieur sur le Continent africain. Ils ont décidé que toute l'équipe technique serait basée au Portugal. C'est donc là-bas qu'est développée l'application Jumia, avec les ordres de Berlin et Dubaï. En Afrique, on est consommateurs. Oui, cela crée des emplois sur le Continent, mais quels emplois ? Ce sont des livreurs et des gardiens d'entrepôts. Voilà l'emploi que Jumia crée en disant qu'ils sont plus de 5 000 employés.
Ils ont levé 800 millions de dollars. Si des startups africaines, fondées sur le Continent et dirigées par des Africains qui comprennent comment achète l'Africain levaient ces 800 millions de dollars, on n'aurait pas vu ce qu'on a vu avec Jumia, c'est-à-dire des pertes de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Alors, pour moi, le business model de cette entreprise montre qu'elle n'a tout simplement pas compris l'Afrique.
Je donne un autre exemple. Le logo de Jumia est un chariot. Cela reprend le modèle de celui ou celle qui va au magasin, remplit le chariot et paye. Et ils demandent après pourquoi les Africains adoptent difficilement leur application. Combien d'Africains achètent en physique avec ce modèle ? Combien d'Africains vont au supermarché avec des chariots ? Les Africains n'achètent pas de cette manière, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'achètent pas. En Afrique, on va au marché. Ils n'ont pas pu adapter leur modèle à l'Afrique, tout simplement parce qu'ils ne sont pas Africains. Ils ont tellement de manque de respect pour l'Afrique qu'ils n'ont pas pensé que s'ils avaient, peut-être, des Africains dans leur top management, ces derniers leur auraient dit que le chariot ne correspond pas trop à la manière d'acheter des Africains...
Dans ce cas, quelle serait la plus grande plateforme de e-commerce en Afrique à votre avis ?
La plus grande plateforme de e-commerce en Afrique n'est pas Jumia, mais Whatsapp. On le sait parce que d'innombrables transactions se tiennent sur ce réseau social. Sans aucun outil informatique avancé, les gens mettent leurs catalogues sur Whatsapp, y postent les photos de leurs biens, les intéressés réservent, payent par mobile money et les parties s'organisent pour la livraison.
Maintenant si des startups du Continent réussissent à prendre ces outils et à structurer une application autour du social e-commerce, elles vont gagner, car il faut une solution africaine à l'Afrique. Et je crois qu'on commence à comprendre la différence entre une startup en Afrique et une startup africaine. La startup africaine est faite de l'Afrique, pour l'Afrique, par des Africains.
Au dernier Sommet Women In Africa à Marrakech en juin, il était question de changer le narratif au sujet de l'Afrique. Vous avez soutenu que «si une entreprise est partout dans le monde et qu'elle n'est pas en Afrique, elle est internationale, mais pas mondiale». Vous déploriez que l'Afrique ne compte pas toujours à juste valeur pour un grand nombre d'entreprises à travers la planète...
La réalité est que bien que l'Afrique soit de plus en plus convoitée, il y a encore un grand nombre d'entreprises dans le monde qui ne travaillent même pas avec des partenaires africains, qui ne regardent pas le potentiel de l'Afrique en termes de marché. Et c'est cela le problème. Il y en a qui ont compris qu'ils peuvent se lancer en Afrique, mais ne font pas d'efforts. Quand ils veulent étendre leurs activités sur le plan l'international, ils n'investissent pas dans ces marchés de la même manière qu'ils le feraient en Asie, en Europe ou aux Etats-Unis.
Je parle avec des chefs d'entreprise dans la Silicon Valley et à chaque fois, certains racontent fièrement comment ils ont fait tel don ou telle œuvre de charité en Afrique. Mais ils ne demandent jamais comment pénétrer le marché du Nigeria à titre d'exemple. Et c'est cela que j'ai envie d'entendre. J'aimerais qu'ils aient un regard différent sur l'Afrique en se disant qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent sur ce Continent, au lieu de nous regarder comme des pauvres.
J'ai apprécié les déclarations du CEO de L'Oréal au Women in Africa Summit qui a dit qu'il voit vraiment l'Afrique comme son plus gros marché. Il a dit que la femme africaine dépense douze fois plus que la femme européenne sur les produits de beauté. Il voit l'Afrique comme un réel marché et je crois qu'il faut qu'on nous respecte de cette façon.
Source: afrique.latribune.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

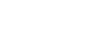

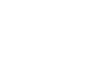

Commentaires