Mati Diop : ``Les luttes doivent converger sur les questions des femmes et des minorités``

Elles s’appellent Céline Sciamma, Mati Diop, Justine Triet et Jessica Hausner. Pour la première fois de l’histoire du Festival de Cannes, quatre réalisatrices sont en lice pour décrocher la très convoitée palme d’or. Entretien avec Mati Diop, la toute première cinéaste sénégalaise en compétition.
Thierry Frémaux a choisi d’ouvrir «de plus en plus grand ses portes aux réalisatrices». Un an après la montée des marches des 82 femmes, le délégué général du Festival de Cannes entend faire la part belle aux femmes cinéastes. Le 18 avril, il annonçait la présence de treize réalisatrices lors de la 72e édition du festival. Un record. Quatre d'entre elles fouleront le tapis rouge avec le secret espoir de décrocher la palme d'or. Outre Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu avec Adèle Haenel et Justine Triet pour Sybil avec Virginie Efira, l’Autrichienne Jessica Hausner abordera, quant à elle, le thème des manipulations génétiques dans Little Joe, tandis que la Sénégalaise Mati Diop présentera son premier long-métrage, Atlantique.
Dans son article Promesses cannoises, les Cahiers du Cinéma reviennent sur les déclarations de Thierry Frémaux, qui affirmait privilégier le talent dans la sélection des longs-métrages. «Laissant entendre à force que les films réalisés par des femmes avaient quelque chose qui manquait pour accéder au grand bassin», peut-on lire. Mati Diop, elle, a déjà fait ses preuves. Quand nous rencontrons la cinéaste, vendredi 17 mai, celle-ci s’apprête à monter les marches du Palais des Festivals pour son film Atlantique. Une jambe de son pantalon est blanche, l’autre noire. Tout un symbole.
Comment vivez-vous votre premier Festival de Cannes ?
Je suis très heureuse, émue et fière de venir présenter le film avec mon équipe. C’est une célébration de tout ce travail. Je le vis comme un moment de reconnaissance. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que j’ai ressenti en montant les marches, en allant dans la salle de projection.
Vous faites partie des quatre réalisatrices en compétition officielle – un record. Pensez-vous que l’on tend vers une parité totale dans le monde du cinéma ?
Il suffit de regarder les chiffres, on est encore loin de la parité. En revanche, c’est important de reconnaître que grâce aux luttes, au travail d’un certain nombre de collectifs féministes, il y a des avancées dont on voit les retombées. Ce que je trouve positif, c’est justement que ce ne soit pas seulement sur ce chapitre qu’il y a une avancée cette année. La présence de deux premiers longs-métrages en compétition montre aussi qu’une nouvelle génération a accès au Festival. Le fait qu’il y ait un film qui représente l’Afrique est très important aussi. Ce que je trouve dynamique et intéressant, c‘est de voir les lignes bouger, mais à différents endroits. Les progrès sont importants, mais ils le seront encore davantage si les luttes convergent, non seulement sur la question de la femme, mais aussi sur celle des minorités. C’est important que de jeunes cinéastes fassent confiance à de nouvelles approches et puissent représenter un maximum de pays. Mais ce qui doit rester central, ce sont les exigences sur le film, le présent et leur vision du monde.
Que pensez-vous de l’instauration éventuelle de quotas au cinéma ?
J’y réfléchis. Je trouve que quand on est programmateur, c’est vraiment un équilibre très délicat à trouver. Je me méfie beaucoup d’une certaine forme de condescendance. Je n’ai pas envie d’être prise à un festival car je suis une femme, ni parce qu’il faut un film qui représente l’Afrique. C’est d’ailleurs la première réaction que j’ai eue quand le film a été sélectionné : est-ce qu’il est bien pris pour ses qualités ? J’extrapole, bien sûr. Je suis maintenant consciente que le film a été pris pour ce qu’il est, mais le fait que je sois une femme d’origine africaine participe aussi à cette sélection. L’écart entre les hommes et les femmes a été tellement énorme jusqu’à présent que l'on doit peut-être imposer un quota égalitaire pour rétablir l'équilibre. Dans ces cas-là, il faut être d’autant plus exigeant avec les films.
Pourquoi avoir ressenti le besoin d'évoquer la jeunesse sénégalaise au cinéma ?
C’est dangereux de vouloir représenter une jeunesse, qu’elle soit sénégalaise ou non. Il y a beaucoup de diversité au sein de la jeunesse sénégalaise. J’ai voulu montrer ses différents visages. Et souhaité faire cohabiter dans un même film deux périodes : celle de la vague massive de départs en mer pour l’Espagne, lorsque beaucoup de jeunes fuyaient le chômage, et celle, en 2012, du printemps dakarois, quelques mois après le début du printemps arabe. Au Sénégal, la jeunesse s’est insurgée, est descendue dans la rue et a mis le président dehors. C’était très inattendu. J’ai voulu faire cohabiter ces deux jeunesses qui sont en fait une seule et même jeunesse.
Comment avez-vous décidé de passer derrière la caméra ?
Je l’ai fait pour l’art. Je viens d’une famille d’artistes, de musiciens. Mon père est cinéaste, ma mère photographe. Dans la photographie seule, il y avait une dimension qui me manquait. La musique, pour moi, c’est un peu trop abstrait. Le cinéma me permettait de manier l’aspect visuel et sonore des choses. C’est la dimension politique du septième art, il y a beaucoup de choses à réparer.
Source: madame.lefigaro.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

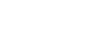

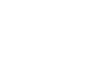

Commentaires