Pour Maïmouna N’Diaye, Il faut que le cinéma africain arrive à faire rêver

Actrice populaire et documentariste, Maïmouna N'Diaye (ou Mouna N'Diaye), qui a été le visage du cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), est l'une des jurées de la 72e édition du Festival de Cannes. Entretien.
Ce n’est bien évidemment pas la première fois que vous participez au jury d’un festival de cinéma. Mais être membre du jury cannois a-t-il une saveur particulière ?
J’ai été membre du jury du Festival de Khouribga (au Maroc), présidente du jury court métrage à Carthage (Journées cinématographiques de Carthage, NDLR) ! C’est une pression d'être jurée et, à Cannes, c’est grandiose parce que je vais aller juger des réalisateurs qui sont, pour moi, de très grands cinéastes et prétendre donner un avis sur leurs films. C'est énorme.
Les films africains sont souvent absents du Festival de Cannes. Que vous inspire ce défaut de représentation ?
Il y a plusieurs critères pour être sélectionné à Cannes. La qualité est évidemment l’un d’eux. Il y a des films africains de qualité qui auraient pu être à Cannes, mais qui n’y sont pas. Je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne. Néanmoins, il faudrait qu’il y en ait un peu plus. Cependant produisons-nous suffisamment de films, comparés à l’Europe ou à l’Amérique Latine par exemple, qui nous permettent d’être représentés dans les mêmes proportions ? L’Afrique produit-elle suffisamment de films pour que, au hasard, 5% de sa production soit par exemple sélectionnée ? Nous sommes encore très loin du compte.
Vous êtes comédienne et réalisatrice. Vous aviez la possibilité de rester en Europe et de poursuivre votre carrière, mais vous avez choisi de travailler sur le continent. Pourquoi ?
Je reconnais que j’ai eu beaucoup de chance. J’ai grandi en Afrique, fait mes études en Europe et je suis ensuite revenue sur le continent. C’est effectivement un choix, parce qu’à un moment donné de ma carrière en Europe, j’ai estimé que j’avais plus à gagner en exerçant en Afrique et j'avais envie de faire des choses depuis le continent. Cela me paraissait évident. Quand j’ai terminé mes études, j’ai travaillé dans des séries et des longs métrages en France. Et puis, il y a eu un creux et plutôt que d’attendre des rôles qui n’arrivaient pas, je me suis dit qu’il serait plus judicieux de collaborer avec des réalisateurs sur le continent. Et toujours pour éviter d’attendre entre deux films et parce que j’aime être active, je me suis lancée dans la réalisation de documentaires. Je joue au théâtre, dans des séries et au cinéma... Je suis en activité en permanence car j'en ai besoin. En outre, si l'on veut que l’industrie cinématographique se développe, il faut permettre aux cinéastes africains de travailler sur place avec nous.
Au dernier Fespaco, dont vous étiez l’ambassadrice, le cinéma africain s’est de nouveau interrogé sur son évolution depuis cinquante ans. Quelle est votre réponse à cette question ?
Il y a beaucoup de choses qui ont changé et d'autres pas vraiment. Cette année, j’ai eu l’immense honneur d’être l’image du cinquantenaire du Fespaco (Festival panafricain du cinéma et de la télévision) pour plusieurs raisons. D’abord, c’est un festival panafricain, mes origines diverses et mes identités culturelles y font écho (Maimouna N'Diaye est Franco-Burkinabè, a grandi en Guinée et est connue dans toute l'Afrique de l'Ouest, NDLR). D'ailleurs quand on les évoque, je réponds que je suis chez moi là où je me sens bien. Je suis internationale, panafricaine et d'origine africaine. Je ne vois pas ma couleur, mais je connais mes cultures. Ensuite, L’Œil du cyclone (2015) et les 12 récompenses qu'il m'a values à travers le monde (dont celle de la meilleure actrice au Fespaco en 2015, NDLR) - le film lui-même en a eu 80 -, y sont certainement pour beaucoup.
Je pense que la place de la femme dans nos cinématographies africaines a beaucoup évolué. Elles sont de plus en plus présentes dans les films, même si leurs rôles restent des stéréotypes, alors qu'il y a d'autres personnages à incarner. Du côté technique, la situation a également évolué. Cela a commencé avec les femmes réalisatrices, des femmes à la caméra, au son, à la lumière… Elles ont réussi à se faire accepter et s’imposer dans ce milieu d’hommes. L’avènement du numérique a contribué à faciliter l’accès aux femmes. Il n’y a pas que des maquilleuses, des scriptes ou des monteuses. A ce niveau, la situation a véritablement évolué et cela fait plaisir.
Avec l’arrivée du numérique, il y a eu également une espèce d’euphorie généralisée où tout le monde s’est senti réalisateur et a pris sa petite caméra pour faire un film. Du coup, le temps d’écriture du scénario, de recherche et de création des personnages a été occulté. On a commencé à faire des films que j’appelle "sapsap" : histoire écrite en moins de deux, tournage du long métrage en deux semaines... De ce que j’en sais, un long métrage se tourne entre six et huit semaines. Et avant, il y a un temps de préparation : les décors à trouver, les costumes à préparer, sans compter le choix des comédiens. Il faut faire toute cette mise en place avant de donner le premier tour de manivelle. Aujourd’hui, il n’y a presque plus cela et c’est ce que je déplore dans l’évolution de notre cinéma.
En outre, au niveau des productions, les réalisateurs manquent parfois d’imagination ou ils ne veulent pas prendre le temps de laisser libre cours à leur imagination. J’estime que le cinéma doit faire rêver, réfléchir et, pourquoi pas, changer les mentalités ou donner un autre point de vue. Cependant, je constate que nous restons encore trop proches de ce que les gens vivent au quotidien. Je suis documentariste, je ne vais donc pas critiquer une telle démarche. Seulement, je considère que la fiction doit aller au-delà. Les Africains n’ont pas forcément toujours envie de voir au cinéma leur réalité, ils veulent être projetés dans une autre réalité. Les gens, les jeunes en premier lieu, vont voir des films étrangers parce que, justement, ils les font rêver, ça les emmène ailleurs. Il faut que notre cinéma y arrive. Nos films doivent être vus en Afrique et au-delà, à l’instar de toutes les autres productions. Nous devons faire du cinéma, un point c’est tout ! Quand bien même il serait question de cinéma africain, parce que les codes veulent que les cinémas aient une appartenance, mais un bon film est un bon film. Il faut qu’on y arrive et l’on y parviendra. La jeunesse est en route !
Le cinéma maghrébin ou celui des pays anglophones est plus dynamique que celui de l'Afrique de l'Ouest et centrale, majoritairement francophones. Comment s'explique cette disparité régionale ?
Il faut qu’on comprenne dans la région francophone que le cinéma est une vraie industrie et qu’on mette en place de vraies politiques culturelles afin que le cinéma soit financé à la hauteur de ce qu’il vaut. Nos politiques doivent comprendre que le cinéma rapporte. C’est une idée qui a décidément du mal à faire son chemin. Tourner un film implique de mettre en place des équipes de femmes et d’hommes qui, grâce à leur travail, peuvent subvenir aux besoins de leur famille. Si on investissait dans le cinéma, je crois qu’on éviterait d'avoir à se battre encore pour éviter de sacrifier l’éducation des jeunes filles au profit de celle des garçons. Payez les études des jeunes filles et vous verrez de quoi elles sont capables ! Tant que le cinéma sera uniquement considéré comme du divertissement, nous n'y arrivons pas.
Le Festival démarre dans quelques heures. A quoi pensez-vous ?
Je suis dans les préparatifs. Je sais ce que je vais faire : regarder de très grands films et je vais passer un très bon moment. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Et j’essaierai de représenter dignement les identités culturelles du continent.
Source : francetvinfo.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

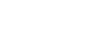

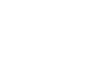

Commentaires