Trahies, battues, violées: l'enfer des prostituées nigérianes en France

«Je croyais qu'une fois en France, j'allais étudier, que l'enfer allait s'arrêter», raconte Joy, forcée à se prostituer pour payer son exil. Comme elle, des centaines de jeunes Nigérianes en quête d'une vie meilleure, finissent, après un voyage traumatisant, sous la coupe d'un réseau de prostitution.
Dans les rues des grandes villes de France, elles sont aujourd'hui les plus nombreuses, devant les filles de l'Est ou les Chinoises, selon les autorités, et pratiquent les tarifs les plus bas, à partir de 10 euros la passe.
La plupart arrivent d'Italie, où elles ont passé jusqu'à plusieurs années. «Les réseaux nigérians se déplacent vers la France en provenance d’Italie», confirme Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l’immigration et de l'intégration (Ofii). La lutte contre les mafias nigérianes engagée par le gouvernement italien a forcé ces réseaux à se déplacer vers le Sud-Est de l'Hexagone.
A Marseille, où la part des prostituées nigérianes a nettement augmenté ces dernières années, Michel Martinez, chef de la brigade de répression du proxénétisme (BRP), a appris à connaître ces réseaux «très organisés»: «Au pays, les filles sont recrutées par une madame, souvent une ancienne prostituée, qui les surveille et les met au travail, tandis que les hommes s'occupent du passage, de la logistique, de récupérer l'argent».
«Des invisibles»
Leur parcours Niger, Libye puis Italie en général dure 2-3 mois «pendant lesquels elles sont privées de nourriture, violées, et elles commencent à travailler car elles n'ont pas d'argent pour payer le voyage». Le prix de l'exode: 50.000 euros en moyenne, qu'elles doivent rembourser en se prostituant.
Happy, qui a aujourd'hui refait sa vie à Marseille, a par exemple laissé derrière elle deux enfants au Nigeria pour fuir un mari violent. Forcée à se prostituer par ses passeurs pour payer son voyage vers l'Europe, elle finit par fuir l'Italie, où elle était «persécutée par la police, les hommes», raconte-t-elle à l'AFP, et traverse les Alpes, enceinte de 8 mois. «C'était terrible», décrit-elle en anglais, «j'ai dû grimper, sauter, courir avec mon gros ventre, mais j'y suis arrivée et j'ai sauvé mon bébé».
Les proxénètes sont très difficiles à «coincer», pointe aussi Michel Martinez: «Ce sont des personnes très peu visibles: elles n'utilisent pas le téléphone, sont très mobiles, changent de perruque, d'adresse, de numéro... Parfois les madames s'échangent même les filles pour brouiller les pistes».
Pour faire tomber les réseaux, la police s'appuie sur les associations, qui peuvent convaincre les filles de porter plainte. Une démarche «extrêmement délicate» selon Lionel Arsiquaud, éducateur spécialisé de l'Amicale du Nid à Marseille, qui a vu «exploser»les arrivées de Nigérianes, qui représentent maintenant 80% de son public. «C'est d'autant plus difficile qu'elles ne se sentent pas victimes de traite humaine», développe ce travailleur social.
«Elles ont peur de tout, ce sont des invisibles», renchérit Elisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof). «Quand elles arrivent en France, elles ont un lourd passif, elles ont été traitées comme du bétail en Libye».
Joy, à qui on avait fait miroiter des études en France, a été recrutée à Benin City, plaque tournante de trafics en tous genres. «Dans mon pays, on ne parle pas de prostitution, on dit qu'on va se faire sponsoriser le voyage», souligne-t-elle. Il y a 10 ans, cette coiffeuse «très pauvre», qui peine à manger chaque jour, fait confiance à un homme qui dit vouloir l'aider.
Dans ses bagages, elle emmène tous les livres qu'elle possède pour ses futures études. Le voyage dure un an, durant lequel son «sponsor», qui l'avait recrutée, la force à se prostituer. «Je couchais avec des hommes arabes, souvent armés, j'étais tellement battue et violée que je ne pouvais plus marcher ni m'asseoir, mais j'étais sûre qu'en France tout s'arrangerait», raconte la jeune femme aux longs cheveux bouclés. Quand elle raconte à ses compagnes d'infortune qu'elle va étudier, «elles se moquent» d'elle.
Rituel vaudou
Arrivée en France, elle comprend que son calvaire ne fait que commencer: «La madame du réseau m'a dit que je lui devais 40.000 euros et que pour ça je devais aller sur le trottoir».
Pour Lionel Arsiquaud, les réseaux ont d'autant moins de mal à tenir les filles sous leur coupe qu'il s'agit de personnes «conditionnées, dans leur pays, à être esclaves de maison ou dans les champs, à ne pas toujours être payées pour leur travail».
Des jeunes filles, parfois mineures, issues de familles «malveillantes et maltraitantes, qui parfois les vendent aux passeurs et à la madame». En général, explique Célia Mistre, directrice de l'Amicale du Nid 13, «elles souhaitent arrêter parce qu'elles sont enceintes ou à cause des violences, pas tant à cause de la prostitution qu'elles ont intégrée psychologiquement comme un poids à porter».
Un fardeau sanctuarisé par le rituel du «juju», un rituel vaudou qui lie les filles jusqu'à la mort à leur «madame». Joy se souvient d'une cérémonie «effrayante, où je devais donner du sang, des cheveux, une dent même». Quand elle trouve la force de quitter le réseau en 2015, sa «madame» appelle ses parents au Nigeria pour les menacer d'activer le «juju» contre eux.
Aujourd'hui maman de deux petites filles nées à Marseille, Joy tente d'obtenir des papiers pour travailler légalement en France. Depuis qu'elle a porté plainte contre ses proxénètes, la trentenaire se sent «comme entre parenthèses», dans l'attente d'une nouvelle vie.
Source : cnews.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

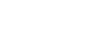

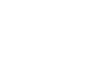

Commentaires