Véronique Tadjo, romancière: ``Les femmes africaines ne sont pas des victimes``

Poète, romancière, peintre, la Franco-Ivoirienne Véronique Tadjo imbrique parole intime et panorama social dans une oeuvre optimiste et engagée, affranchie du regard occidental. Rencontre.
Peut-on vous présenter comme une écrivaine africaine?
Écrivaine, écrivaine africaine, écrivaine francophone... tout me va. Pourquoi? Parce que je suis née à Paris, et que je suis née une deuxième fois en Côte d'Ivoire. J'y suis née en tant que femme et en tant qu'écrivaine. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas sensible à ce qui se passe dans le monde. J'ai vécu aux Etats-Unis, au Kenya, au Nigeria... quatorze ans en Afrique du Sud. J'habite en ce moment à Londres. Le fait est que mes premières sources d'inspiration sont africaines. Il est vrai aussi que je revendique un héritage littéraire issu du continent. La tradition orale côtoyée pendant mon enfance et mon adolescence à Abidjan a beaucoup nourri mon écriture. Tout comme les poètes de la négritude: Césaire, Senghor, Birago Diop, Léon-Gontran Damas. J'ajoute que j'ai été aussi nourrie par les classiques français. J'ai eu accès aux auteurs anglophones puisque je me suis spécialisée en culture afro-américaine pour soutenir une thèse de doctorat à l'université de la Sorbonne, à Paris. Ceci n'empêche pas cela.
En quoi cet héritage littéraire africain est-il spécifique?
Ses expressions sont complémentaires. Senghor l'a dit et redit: les poétesses populaires sérères [peuple du Sénégal] de son village natal ont beaucoup influencé sa poésie. Il a même traduit certains des poèmes-chants qu'il disait avoir écoutés à 10 ans. Certains livres d'Alain Mabanckou procèdent directement de l'oralité. Quand il écrit Mémoires de porc-épic, l'idée d'un personnage doté d'un double animal, c'est l'essence même du conte africain. Le phénomène est identique chez les anglophones. Le Nigérian Ben Okri emprunte aux légendes yorubas. La Route de la faim, roman couronné par le Booker Prize (1991), gravite ainsi entre la terre et le monde invisible des esprits.
Vous-même donnez voix à des personnages féminins de légende. La reine Pokou, par exemple, qui vous a inspiré un récit (Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2005).
La reine Pokou a véritablement existé, on a bien retrouvé ses traces, on sait qu'elle a vécu au XVIIIe siècle et fondé le royaume baoulé au centre de la Côte d'Ivoire. La légende s'en est emparée, cruelle. Pour sauver son peuple, la reine aurait sacrifié son fils unique. La légende est toujours très vivante dans l'imaginaire des Ivoiriens, parce que c'est un mythe de fondation. Félix Houphouët- Boigny, le premier président, était baoulé, le deuxième [Henri Konan Bédié] l'était aussi. Tous deux l'ont utilisée pour légitimer la domination du Sud sur le Nord, contribuant, avec le temps et la crise économique, à la fracture ethnique.
Au-delà de cet aspect politique destructeur, ce qui m'a frappée, en tant que femme, en tant que mère, c'est que la légende ne donne pas la parole à Pokou. L'histoire ne dit rien de son immense souffrance. Le message de la légende peut avoir un impact profondément négatif. Il valide l'idée qu'on puisse sacrifier un enfant. Je pense aux enfants soldats, aux enfants pris dans l'enfer des guerres. Ne pas préserver l'enfance est une faillite terrible de la société, un immense gâchis. Il me paraissait important de questionner ce mythe, totalement anachronique aujourd'hui.
Vous avez témoigné sur le processus de réconciliation au Rwanda.L'Ombre d'Imana (éd. Actes sud) est le récit d'un voyage en 1998. Qu'avez-vous vu?
Les femmes souffrent particulièrement de la guerre. Des femmes violées sont mortes des années plus tard du sida. Mais cela a été un choc de découvrir que certaines avaient participé au génocide. J'avais ce préjugé que l'être féminin est par nature aimant, protecteur. Il m'a fallu accepter la réalité de la femme tueuse. Une douche froide. Au point que j'ai hésité à le dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que subsiste un espoir. Dans cette période tragique, des gens ont dit "non". Des Hutus ont abrité des Tutsis au péril de leur vie. Même dans un pays en guerre, il y a des gens qui s'élèvent jusqu'à l'extraordinaire.
Loin de mon père, situé à Abidjan dans les années 2000, illustre à nouveau l'impact de la guerre sur la société. Cette fois, sur la famille. Le thème est la fracture de la guerre civile: comment, en effet, elle menace une famille d'imploser. Cela passe par l'attitude du père. L'héroïne, Nina, revient de France à Abidjan pour les funérailles de son père. Elle découvre à cette occasion tout un pan de sa vie qu'elle ignorait. Des croyances archaïques, un manuel de sorcellerie dont il avait l'usage. Cela lui semble invraisemblable de la part d'un homme instruit, occupant une position enviée. Plus grave, Nina apprend l'existence de nombreux frères et soeurs. Ses tantes et cousins sont au courant. C'est un secret de Polichinelle. Elle se sent trahie. Par amour pour le défunt, elle reste. Et peut-être par amour pour son pays.
Comment l'expliquez-vous?
Parfois on aime une personne, en privilégiant le meilleur. On ne veut pas connaître ses peurs, ses angoisses, ses aspects sombres. Les rapports entre les gens sont souvent dangereux. Il y a le risque de se perdre, mais ça vaut le coup. C'est un peu pareil avec un pays. Quand il se passe quelque chose de décevant, d'effrayant, le lien survit-il? Dans les sentiments, cohabitent joie et douleur. Tout ça fait un amour. Pour un pays ou pour un individu.
C'est aussi le sujet de la polygamie que vous abordez dans ce livre...
La polygamie existe aujourd'hui sous une forme pervertie. Certains hommes entretiennent des relations suivies avec une ou plusieurs femmes autres que l'épouse officielle. Ils ont une vie cachée, des familles parallèles. Ce qui revient, somme toute, à des adultères. C'est très nocif, dans la mesure où les maîtresses et les enfants ne sont pas reconnus. Les femmes sont dépendantes d'un homme, tout en étant marginalisées. Les enfants sont perdus, privés de l'ancrage d'une cellule familiale.
A l'instar de l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie, avez-vous une prise de position féministe?
Je comprends que le terme résonne en Amérique où elle vit. Pour ma part, j'aurais du mal à l'employer. Je suis bien sûr du côté des femmes. Qu'elles atteignent le plus d'égalité possible. Qu'elles aient plus de place dans la société. Mais je me méfie des étiquettes et le féminisme ne me convient pas tout à fait parce qu'il fait appel à une histoire, à des mouvements qui se sont essentiellement développés en Occident. En fait, il s'agit, je crois, d'un malentendu. On ne vit pas dans les mêmes sociétés. Il y a des réalités africaines que les féministes n'ont pas comprises. Prenons l'excision. La coutume, qui mutile la féminité, est condamnable: il faut l'éradiquer. Mais comment? Il faut trouver des solutions qui tiennent compte du rite d'initiation qu'il implique. Imaginer une cérémonie qui soit unsymbole du passage du statut de jeune fille à celui de femme. Sinon, les gens continuent à faire ce qu'ils veulent en secret car cela correspond à quelque chose de très profond dans leur façon de vivre. Il est intéressant de savoir que l'excision n'existe pas dans beaucoup de pays. Même chose pour la circoncision.
Les cultures sont très différentes d'une région à l'autre de l'Afrique J'aimerais qu'on se débarrasse totalement de l'idée que les femmes africaines sont des victimes. Elles ont plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. En vertu notamment du matriarcat qui perdure, même si la colonisation a renforcé le patriarcat. Le processus d'accession au pouvoir politique ressemble à ce qui se passe ailleurs. C'est long. La parité au parlement est acquise en Afrique du Sud. Au Rwanda aussi.
En Afrique du Sud, Nkosazana Dlamini-Zuma, ex-épouse de l'actuel président Jacob Zuma, présidente de la commission de l'Union africaine, est une candidate très en vue des prochaines élections [en 2019]. Il y a et il y a eu des femmes chefs d'Etat en Afrique: Joyce Banda a ainsi dirigé le Malawi de 2012 à 2014 ; Catherine Samba-Panza, la République centrafricaine, de 2014 à 2016 (en tant que présidente de transition pendant la crise de son pays) tandis qu'Ellen Johnson Sirleaf est la présidente du Liberia depuis 2006.
Vous êtes également peintre. Quelles sont vos sources d'inspiration?
Le réalisme magique. Je m'inspire aussi de la conception africaine de l'art. Si je fais un portrait, c'est celui de la personne que je perçois, en tant qu'individu. On me dit que mes peintures sont très identifiables à l'Afrique de l'Ouest. A cause des couleurs que j'utilise. En Côte d'Ivoire, la lumière est brillante, intense, lorsque le soleil tape fort.
Source: lexpress.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

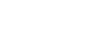

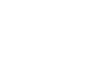

Commentaires