"J'ai été violée 70 fois en 17 ans de rue"...

"Parce qu’on est invisible et en marge de la société, nos agresseurs pensent que notre corps est à leur disposition." Bras repliés sur le buste et ongles rongés, Martine*, une ancienne SDF, raconte l'enfer des femmes sans-abri. "J’ai été agressée sexuellement une dizaine de fois dans la rue", continue cette quinquagénaire. Le pire, selon elle, "c’est que ça devient normal, ça fait partie du quotidien". Il lui a fallu dix ans pour mettre des mots sur ce qui lui est arrivé. "Pour éviter de craquer, mon cerveau a décidé de faire comme si c'était normal."
"Environ une femme SDF sur trois a été agressée", explique Agnès Lecordier, présidente d'une fondation à son nom. L'association Entourage avance qu'une agression sexuelle sur une femme SDF a lieu toutes les huit heures en France. "En réalité, aucune étude n’a été faite sur le sujet, il est impossible d’avoir des chiffres", reprend Agnès Lecordier. Mais tous les interlocuteurs contactés sont formels : les femmes en errance sont très fortement exposées aux agressions sexuelles et aux viols.
"On apprend à voir chaque homme comme un agresseur potentiel"
"Ici, toutes les femmes ont été confrontées à ce type de violences", affirme Quentin Le Maguer, le responsable d’un centre d’hébergement d’urgence au Samu social de Paris.
''Ces femmes sont plus vulnérables car en marge de la société. Leur non-existence légale en fait des proies pour les agresseurs''. Quentin Le Maguer
"Les agressions dans la rue, cela va du père de famille qui essaie de vous violer pendant que vous dormez au réseau mafieux qui monnaye un coin de trottoir", soupire Martine. Elle se souvient d’une adolescente ukrainienne, âgée de 15 ans à peine, qui devait chaque soir se soumettre à un homme pour pouvoir faire la manche le lendemain sans être violentée. "On apprend à voir chaque homme comme un agresseur potentiel."
La première fois qu’elle-même a été agressée, Martine avait 22 ans. En rupture familiale, elle passait ses premières nuits dehors, réfugiée sous un Abribus : "L’employé d’un hôtel proche est sorti et m’a proposé de passer la nuit dans une chambre inoccupée, j’ai compris trop tard de quoi il s’agissait." Meurtrie, elle refuse d’en dire plus. Ses lèvres tremblent et son regard se pose sur son café.
"On ne parle des SDF que quand il fait froid..."
"J'ai été violée 70 fois en 17 ans de rue", confie Anne Lorient, ancienne SDF, qui raconte son calvaire dans Mes années barbares (éd. La Martinière), co-écrit avec la journaliste Minou Azoulai.
''J'ai été violée par d'autres sans-abri mais aussi par des hommes avec un domicile, qui m'ont dit que j'étais moins chère qu'une prostituée.''Anne Lorient
"Certaines femmes passent des accords pour avoir accès à un hébergement", note Karine Boinot, psychologue clinicienne et auteure d’une thèse sur la souffrance psychique des personnes sans-abri. “Des femmes qui ont effectué un parcours migratoire arrivent souvent en France sans repères et ne maîtrisent pas la langue, fait aussi remarquer Quentin Le Maguer. Elles se retrouvent hébergées par des réseaux, prostituées de force ou dans des situations d’esclavage moderne chez des particuliers."
Ces agressions quotidiennes se déroulent dans l’indifférence générale. "Le grand public n’est pas du tout au courant de cette réalité. On ne parle du quotidien des SDF que quand il fait froid dehors", soupire le responsable de centre d'hébergement d'urgence. Selon le dernier recensement de l’Insee, qui date de 2012, 38% des personnes sans-abri sont des femmes. Un chiffre relativement peu connu.
De la difficulté de porter plainte pour les victimes
Le 6 août dernier, Elvire boit un verre avec deux amies, sur une place du premier arrondissement de Marseille. La jeune femme met plusieurs minutes avant de réaliser qu’une personne SDF est en train de se faire violer, sous ses yeux. "Parce qu'ils semblaient SDF, personne n'y prêtait attention", se souvient-elle, encore choquée d’avoir assisté à cette scène en plein après-midi. "C’est une indifférence au sort des SDF qu’on a accepté dans le paysage", souffle Agnès Lecordier.
Une absence d’existence qui empêche les victimes de porter plainte : "Une personne ne peut pas parler de ses souffrances quand elle a perdu confiance dans la société", analyse Samuel Coppens, le porte-parole de l’Armée du salut. "Elles vivent avec la peur de ne pas être crues, certaines ont peur d’avoir une responsabilité dans ce qui leur arrive", se désole-t-il.
Pour Karine Boinot, il existe une défiance envers les autorités. "Moi les policiers, je leur crache dessus", s’emporte Marie, une femme SDF, près de la gare de Lyon, à Paris. "Ils n'ont jamais rien fait pour m’aider, je pourrais crever, ils ne s’approcheraient pas !" Anne Lorient a porté plainte une dizaine de fois et fait une expérience amère :
''C'est très dur de porter plainte, les SDF ne sont pas les bienvenues dans les commissariats. Ce sont les hôpitaux qui m'ont reçue qui ont souvent porté plainte à ma place''.
Contactées à ce sujet, la préfecture de police et l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ont simplement expliqué à franceinfo ne pas avoir de données sur les personnes non logées.
Des menaces jusque dans les centres d'hébergement d'urgence
De nombreuses femmes développent des stratégies pour échapper à leurs agresseurs. "Dès qu’un mec s’approche, je m’urine dessus pour le faire fuir", raconte Marie d’un haussement d'épaules. "Parfois, cela ne suffit pas." Elle hausse à nouveau les épaules. Cela fait bien longtemps, dit-elle d’un air détaché, qu’elle ne ressent plus rien. "Une grande partie de leur énergie est dépensée pour se protéger", remarque Agnès Lecordier. "Certaines dorment le jour à proximité des lieux sécurisés, comme les gares. L’important, c'est de sentir qu’il y a du monde." La nuit, elles marchent ou restent dans les bus. "D’autres se regroupent entre elles ou se mettent sous la protection d'hommes."
Les travailleurs sociaux interrogés s'accordent sur un cas : celui des femmes qui vivent dans la rue depuis trop longtemps. "Au bout d’un moment, elles renoncent à l'hygiène et à la propreté", alerte Agnès Lecordier. "Elles disent 'tant pis' pour leur corps. S’entourent d’immondices pour se protéger des hommes." A ce stade-là, il devient difficile de se reconstruire : "Elles sont inaccessibles, se protègent à l'extrême."
Les centres d'hébergement d’urgence, qui accueillent ces femmes pour une courte durée, ne sont pas sans risque pour elles. Elles refusent d’aller dans des centres d'hébergement mixtes, car elles ne se sentent pas en sécurité. Il y a eu des viols à l’intérieur même de ces 'refuges'.
Certains centres sont réservés aux femmes. "Mais il y en a très peu. Seulement quatre ou cinq à Paris", accuse Agnès Lecordier. Pourtant, cela semble à certains travailleurs sociaux indispensables pour se reconstruire. "Retrouver confiance, pour ces femmes, passe par le fait qu’il n’y ait pas de menace. Et l’homme, pour une femme victime d’agression, est forcément une menace", argue Samuel Coppens.
Quentin Le Maguer dirige l’un d’entre eux, situé dans un ancien hôpital de banlieue parisienne. Les murs sont joliment peints en pastel, des dessins d’enfants égayent les murs. Chaque semaine, un gynécologue et un psychologue discutent avec les femmes hébergées, principalement des migrantes. "Les héberger ici, c’est réduire les risques de la rue, éviter les populations dangereuses pour elles", explique le directeur. Mais, de son propre aveu, les places sont rares.
"Tous les efforts ont été faits sur le bâti"
Pourtant, pour Karine Boinot, la reconstruction de ces femmes passe par la fixation dans un lieu de vie et le suivi psychologique. "C’est un long processus, souffle-t-elle. Certaines sont aidées par les rencontres qu’elles peuvent faire, des bénévoles et des professionnels." Mais toutes ne peuvent être prises en charge dans ces structures. "La prise en charge, quand il y en a une, n’est pas la même partout, nuance une source anonyme. Certains centres se contentent de fournir des lits, sans considération aucune pour la dimension psychologique." Les centres d'hébergement sont gérés par des associations, elles-mêmes financées par l’Etat ou les dons.
"Au Samu social, vu le budget qui nous est alloué par l’Etat, on ne peut pas financer des groupes de parole ou un suivi psychique. On est obligé de se tourner vers des dons", regrette Quentin Le Maguer. Il déplore que cette reconstruction après les agressions ne soit pas la priorité de l’Etat. "Tous les efforts ont été faits sur le bâti au détriment du cadre humain", abonde Samuel Coppens. Pourtant, difficile de s’en sortir pour ces femmes "abîmées", "en morceaux", sans que leur souffrance soit prise en compte.
* Le prénom a été changé
Photo d'illustration
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

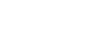

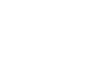

Commentaires