Violée donc coupable d`avoir déshonoré ma famille, j`ai dû fuir

Menacée de mort par les violeurs qu’elle a dénoncés, battue par ses parents et blâmée par tout son village, Emina* a fui son pays. Pour rester en vie. Et se reconstruire. Choisir son mari, parler à un garçon, s’habiller comme on veut ou encore être dehors lorsqu’il fait nuit…
Ces comportements paraissent banals. Ma culture, elle, les voit d’un très mauvais œil, lorsqu’il s’agit d’une femme. On dit alors de ces agissements qu’ils «déshonorent» la famille. Il en était ainsi dans le petit village d’Asie centrale où j’ai grandi. Aînée d’une fratrie de sept, j’ai donc toujours fait attention à me comporter selon le «code d’honneur» propre à mon éducation.
Les études pour me protéger du mariage
J’avais environ 18 ans lorsque j’ai réussi à convaincre mes parents de me laisser poursuivre mes études. Mon père était d’accord, à condition bien sûr que je sois de retour des cours avant la tombée de la nuit. J’étais si heureuse de pouvoir étudier et côtoyer d’autres jeunes! En plus, les études me permettaient de repousser un éventuel mariage arrangé par mes parents… Mais voilà qu’un après-midi, en rentrant du collège, la route principale empruntée par le bus s’est retrouvée barrée, et je suis descendue pour continuer à pied. Le ciel commençait à s’assombrir. Il n’y avait presque personne. Mais bientôt la vue de deux policiers, à moto, m’a rassurée: avec eux dans la rue, j’étais en sécurité… Sauf qu’une fois arrivés à ma hauteur, ils ont freiné et ont passé un mouchoir sur mon visage. J’ai commencé à me sentir bizarre. Je ne sentais plus mon corps. Je ne parvenais plus à bouger. On m’a mise dans un camion. Je ne me rappelle pas grand-chose… un champ… énorme… désert. Et puis trois hommes en plus des policiers. Je ne les connaissais pas. Je pleurais. Eux m’ont violée, chacun à son tour. Et menacée de me tuer si je racontais quoi que ce soit. Tremblante, j’ai juré de ne rien dire à personne. Alors ils m’ont laissée «libre», au bord d’une route. De retour à la maison, ma mère a tout de suite compris qu’il était arrivé quelque chose de grave. Mon père était furieux. Je m’excusais, faisais de mon mieux pour trouver une explication, tenter de les calmer… Sans grand succès.
Descente aux enfers
Les jours suivants, je n’ai parlé à personne de mes viols. Jusqu’à ce que ma meilleure amie me dise: «Ton regard est triste, Emina, qu’est-ce que tu as?» Là, j’ai fondu en larmes, et je me suis confiée à elle, lui faisant promettre de ne répéter mon récit à personne. J’étais naïve. Elle l’a raconté à son copain, qui l’a répété à d’autres… Certaines personnes m’ont promis de l’aide, m’ont convaincue de porter plainte. J’ai rencontré une juge. Mes parents ont été mis au courant du viol par une sorte d’assistant social qui leur a assuré que cette histoire resterait «en ville». Le village n’en saurait rien. Rapidement, les cinq violeurs ont été appréhendés et emprisonnés. Mais les choses ont mal tourné pour moi. L’histoire s’est répandue. Bientôt, tout le monde savait. Dans le village aussi, bien sûr. Et les gens se sont rangés du côté des criminels. Même mes parents, qui jusque-là s’étaient montrés tristes pour moi. «Tu ne sers à rien, il aurait mieux valu que tu meures!» disaient-ils. La coupable, c’était moi. Tout était de ma faute: n’avais-je pas voulu aller au collège? Ce fut le début de mon calvaire. Mon père et ma mère me frappaient. Et lorsque deux des cinq criminels ont été libérés, mes parents ont eu peur pour leur sécurité. Ils craignaient de devoir fuir le village «à cause de moi».
A deux reprises, ma mère a tenté de m’étrangler… Par téléphone, les violeurs menaçaient de me tuer si je «continuais». Continuer quoi? A vouloir retrouver un semblant de vie normale? Je ne souhaitais qu’une chose: leur condamnation. Je savais au fond de moi que cela n’arriverait pas… Et comme j’avais porté plainte contre deux policiers, la police aussi était contre moi. Le système dans son ensemble était corrompu. Si je persistais, on me tuerait. Et puis, il y a eu une conférence, organisée par une association locale œuvrant pour les droits de la femme. On m’y a présenté un homme qui travaillait pour une organisation humanitaire. Nous avons beaucoup discuté. Je lui ai raconté ce qui m’arrivait, je lui ai dit vouloir en finir avec ce cauchemar – soit je partais, soit je mourrais. Il m’a promis de faire quelque chose. Moi je n’avais plus confiance en personne, je n’attendais rien. Pourtant, c’est grâce à lui que la fondation suisse Surgir a eu connaissance de mon histoire. Elle a tout entrepris pour me faire venir ici. Les préparatifs ont duré un mois. Fin 2012, à l’âge de 19 ans, je quittais mon pays. J’avais le sentiment que plus jamais je n’y retournerais. Cela m’a fait mal. Ne plus revoir les miens… Mais je n’avais pas d’autre choix: «l’honneur de la famille» n’était-il pas bafoué à jamais?
Seconde naissance
J’ai laissé derrière moi la fille du village… Et mon arrivée en Suisse a été comme une seconde naissance. Par le biais de Surgir, j’ai été placée en famille d’accueil pendant deux ans. Au début, mes hôtes et moi communiquions en anglais. Ils m’ont beaucoup aidée! Ils m’ont ouverte à une culture complètement nouvelle. Et, surtout, ils m’ont acceptée. Tous: les parents, les enfants, les grands-parents, les cousins, les amis. Jamais je ne me suis sentie étrangère. Pendant près d’un an, j’ai fait de terribles cauchemars; les horreurs vécues me hantaient; et ma famille d’accueil était toujours là pour me rassurer. En même temps, toujours grâce à la fondation, j’ai pu suivre une psychothérapie et des cours de français… Par sécurité, mes parents ne savent pas où je vis – je pourrais encore être la cible de représailles. Je les appelle parfois. Surtout pour leur faire plaisir car, moi, je ressens encore de la colère. J’essaie de comprendre… Aucun parent ne souhaite faire du mal à ses enfants. Mais, dans mon pays, «la société» est plus puissante que les liens du sang. C’est elle qui décide. Nous sommes «ses» enfants.
Prisonniers du qu’en-dira-t-on.
Ici, je me sens libre. Je peux faire des études, sortir le soir, discuter avec des garçons, m’habiller comme j’en ai envie… Je peux être une femme. Et je me sens forte. Là d’où je viens, il est difficile de rêver car même les rêves ont des limites. Ici, j’ai laissé tomber ces barrières! J’ai pu entamer un apprentissage. Je me vois travailler et construire ma vie en Suisse. Je suis motivée. Peu m’importent les obstacles, je sais que je vais y arriver.
Source: femina.ch
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

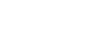

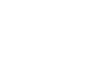

Commentaires