Hemley Boum : « On n’a pas offert aux Camerounais des raisons d’être fiers »

[…] Hemley Boum a construit une saga romanesque qui convoque cinq générations d’hommes et de femmes, compagnons de lutte imaginaires d’Um Nyobè. Foisonnant de détails, ce roman lumineux explore la complexité des êtres et des sujets, dit les désordres humains, sociaux, politiques, les petites joies, l’amour, l’amitié… Rencontre.
Vous avez souhaité redonner vie à une histoire effacée, interdite. Il y avait urgence?
Régulièrement, les Camerounais rallument le débat sur le colonialisme, se désolent de la non-célébration de leurs héros. Cela traduit un profond désir de voir leurs souffrances reconnues. Entamée par l’Administration coloniale et poursuivie par le gouvernement camerounais avec le soutien de l’ex-métropole, la lutte contre les maquisards a engendré de profonds traumatismes. Pendant plusieurs décennies, des villages entiers se sont tus par peur des représailles, mais les plaies sont restées ouvertes. Il est temps d’affronter ce passé.
Pourquoi est-ce si important ?
La conscience qu’un peuple a de sa grandeur se construit. On n’a pas offert aux Camerounais des raisons d’être fiers de leur histoire. Alors que ce combat pour l’indépendance aurait dû en être une, on a organisé leur amnésie. Aucune lecture de cette histoire ne leur a été proposée. Ni une version qui encense les maquisards ni une version qui les condamne. C’est le vide total. Le silence est insidieux, destructeur : il entretient un mal-être.
Pourquoi avoir choisi d’en faire une fiction ?
Je ne souhaitais pas publier un essai politique, encore moins un manuel d’histoire, même si le livre est assez documenté et même si je me suis approprié des figures historiques. Le lieutenant-colonel Lambert, par exemple, fut responsable des zones de pacification. Un colon semblable à Pierre Le Gall terrorisa les Bassas pendant plusieurs décennies. Les viols ont existé. Avant les indépendances, sur le continent, d’importantes communautés de métis témoignaient de l’asservissement des femmes indigènes.
Au Cameroun, les métis étaient peu nombreux. Ce qui interpelle sur le sort des enfants nés de ces viols. La romancière que je suis comble les vides avec des symboles. Comme celui de l’enterrement de dizaines de petits corps, fruits des viols perpétrés par Le Gall. Les discours publics d’Um Nyobè sont réels. Bien qu’ils ne soient pas restitués à la lettre, l’esprit demeure. Ceux que je lui attribue dans la sphère privée sont imaginaires. Et je me suis imposé d’ancrer mon récit dans la culture des Bassas, qui ont payé un très lourd tribut à cette lutte.
Est-ce le rôle de la fiction de dévoiler ou d’enseigner l’histoire ?
C’est un sujet très peu abordé dans la fiction. Mongo Beti s’en était emparé dans Remember Ruben, Max Lobe le fait avec Confidences (lire encadré). La fiction permet de faire œuvre de vulgarisation. J’aimerais que ce livre et ses personnages vivent. Ils racontent une histoire qui doit être entendue. Les jeunes générations en particulier doivent se la réapproprier. Elles doivent savoir que les origines de l’État postcolonial au Cameroun sont tachées de sang. Que les maquisards étaient parfois des paysans de rien avec un idéal clair pour leur pays. Qu’on leur doit la toute première tentative d’articulation de l’idée nationale au Cameroun, alors que la plupart ne comprenaient pas grand-chose à la marche du monde.
Vous accordez une large place aux personnages féminins. Une manière pour vous de mettre l’accent sur leur rôle pendant cette guerre d’indépendance ?
Si les hommes ont été oubliés, que dire des femmes ? J’ai voulu leur restituer leur juste place auprès de leurs compagnons de lutte. Les nationalistes ont survécu dans le maquis grâce à leur implication. Lorsque Um Nyobè est abattu, plusieurs militantes faisant partie du premier cercle de ses collaborateurs sont elles aussi assassinées. Qui se souvient d’Irène Ngo Biyong, Gertrude Omog, Marthe Moumié, Esta Ngo Manguele ? On doit à cette dernière, retrouvée errant dans la forêt après la mort du leader upéciste, le récit des circonstances de son élimination.
Pour mon roman, j’ai donc voulu des personnages féminins puissants non seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la société et plus encore en politique. En fouillant dans des manuels d’anthropologie, en interrogeant les gens, j’ai découvert l’existence du Kô’o, un ordre de prêtresses dont le nom en bassa signifie « escargot », une métaphore du clitoris. Guérisseuses chargées de veiller sur l’harmonie du groupe, elles étaient écoutées et avaient de réels pouvoirs. Combattu par les Églises chrétiennes parce que soupçonné de sorcellerie, cet ordre a continué d’exister clandestinement.
Deux autres protagonistes inattendus figurent également dans Les Maquisards : la forêt et la langue bassa.
Il m’a semblé essentiel d’étudier l’environnement du maquis : la forêt, où s’ancre la culture bassa au quotidien, tant dans sa dimension sociale que spirituelle. Hostile et inconnue pour l’occupant, elle fournit aux maquisards un refuge. Cette approche m’a également permis de mettre en lumière leur spiritualité, leur manière de vivre. Je campe une population rurale confrontée au prosélytisme des colons et à la remise en question de leur mode de pensée et d’existence.
Quant à la langue bassa, enseignée dès l’école primaire, elle a fait partie intégrante de la stratégie de lutte des nationalistes camerounais. Méprisée par le colon, elle favorisait un entre-soi. Les directives et le courrier étaient échangés en bassa, ce qui en faisait une sorte de code. Et le traducteur était souvent acquis à la cause nationaliste. Mais il n’y avait pas que le bassa. Um Nyobè était polyglotte. Au gré de ses déplacements à travers le pays, il haranguait les foules dans leur langue, ce qui a donné une dimension nationale à un combat qui sinon serait demeuré ethnique.
Paradoxalement, la langue bassa a aussi permis de tisser des liens avec l’occupant. Les Français qui la parlaient étaient mieux acceptés. Orphelin très tôt, materné par les femmes du village, le fils Le Gall, qui la maîtrise, fait partie de la communauté. Il y a plusieurs entrées dans ce livre, que je n’ai voulu ni clivant ni manichéen. Car malgré le climat d’immense oppression qui régnait, il y a eu de belles personnes, de belles rencontres. Une humanité s’est créée.
Source : jeuneafrique.com
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

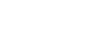

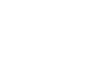

Commentaires