Ethiopie : jetées par leurs employeurs libanais, les « bonnes » tentent de se reconstruire

Deux domestiques éthiopiennes cachant leur visage dans une rue de Beyrouth en juin 2020, après avoir été jetées à la rue par leur employeur libanais.
Elles débarquent à l’aéroport d’Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie, par vagues successives depuis un an. Des centaines et des centaines de femmes, rapatriées par les autorités éthiopiennes, qui travaillaient comme domestiques au Liban avant de se retrouver sans toit ni emploi.
Pendant des mois, alors que le pays du Cèdre s’enfonçait dans une crise économique, sociale et sanitaire, elles ont attendu sur le trottoir du consulat éthiopien de Beyrouth. Certaines jetées là par des employeurs venus les déposer en voiture comme on se débarrasse d’encombrants.
Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 60 000 migrants éthiopiens ont été rapatriés du Moyen-Orient depuis janvier 2020. Des hommes, souvent employés en Arabie saoudite et au Yémen, mais aussi quantité de femmes, recrutées comme « bonnes » au Levant et dans la péninsule.
Sur les quelque 250 000 domestiques étrangères travaillant au Liban, on estime que près de la moitié sont éthiopiennes. Des travailleuses de tous âges, souvent venues de milieux modestes et ruraux, à qui des agences de recrutement ont fait miroiter l’eldorado.
Un nouvel appel d’air dû au Covid-19
Coups, harcèlement, privation de nourriture, exploitation… Au Levant, les « bonnes » sont souvent confrontées aux abus et au racisme de leurs employeurs. Leur salaire – quand il leur est versé – oscille entre 100 et 300 dollars par mois. Un montant à peu près deux fois supérieur au revenu moyen en Ethiopie, mais qui est loin de compenser les maltraitances que certaines subissent.
Le phénomène est tel que plusieurs centres ont ouvert en Ethiopie pour prendre en charge les revenantes, notamment depuis la grande vague de rapatriement de 2013, suite à un coup de filet des autorités saoudiennes contre les sans-papiers. A l’époque, plus de 160 000 Ethiopiens avaient été expulsés du Moyen-Orient. Malgré les fermetures de frontières et les restrictions de déplacement, le Covid-19 a créé un nouvel appel d’air.
« Nous avons été très surpris de l’afflux. En temps de pandémie, on s’attendait justement à une accalmie », confie Fiseha Melese, responsable des programmes d’Agar, une association qui vient en aide aux Ethiopiennes rapatriées.
Après un rapide test psychologique à leur départ à Beyrouth puis à leur arrivée à Addis-Abeba, les femmes les plus fragiles sont dirigées vers des structures comme Agar, qui compte trois centres dans la capitale éthiopienne – un pour les hommes et deux pour les femmes. Créée en 2005 pour subvenir aux besoins des personnes âgées, l’association s’est reconvertie il y a sept ans dans l’accompagnement psychologique des migrants victimes de violences au Moyen-Orient. Au total, elle a accueilli 911 femmes en 2020. Presque deux fois plus que les années précédentes.
« Maltraitées, déprimées, sexuellement agressées »
Elles sont vingt-quatre à vivre aujourd’hui dans l’un de ses refuges, une maison anodine de trois étages en bordure d’Addis-Abeba. Complètement protégées du monde extérieur, nourries, logées, blanchies, les pensionnaires peuvent rester jusqu’à un an, selon leur état. Certaines sont là depuis quelques jours, d’autres depuis plus de six mois. Elles sortent peu, essentiellement pour des rendez-vous avec des psychiatres à l’hôpital.
« C’est comme un puzzle qu’il faut reconstituer, explique Eden Ayele, la psychologue de l’association Agar. Nous avons affaire à des femmes maltraitées, déprimées et parfois sexuellement agressées. L’une d’entre elles est restée neuf mois enfermée dans une cave. On l’obligeait à faire du pain, à raison de quinze heures par jour. Elle n’a pas vu la lumière du jour pendant presque un an. »
Connu pour ses effets délétères, le système libanais du kafala (tutelle) est la porte ouverte à beaucoup d’abus. En toute impunité, certains employeurs confisquent les passeports de leurs domestiques ou restreignent les mouvements. C’est pour échapper à ces mauvais traitements que Wekitu Nata a fui sa « Madame ».
Finis les coups, les insultes, les retards de paiement. Finis aussi les papiers qui lui permettaient de travailler légalement au Liban. La jeune femme, vêtue de ses seuls habits de domestique, a erré au hasard des rues de Beyrouth jusqu’à trouver des compatriotes prêts à l’héberger. Elle a vécu plusieurs années clandestinement dans la capitale libanaise avant d’être rapatriée en décembre 2020.
Dignité bafouée
Trois ans après s’être échappée, Wekitu est toujours hantée par son ancienne employeuse. Elle a tenté à trois reprises de se suicider et garde de son séjour au Liban des stigmates physiques, notamment de graves problèmes gastriques parce que sa patronne l’a « privée d’eau potable pendant six mois ».
Les cas d’attouchements et d’agressions sexuelles sont également fréquents. D’après Eden Ayele, certaines des domestiques prises en charge par Agar ont été forcées de regarder des films pornographiques avec leurs employeurs libanais. « C’est leur dignité qui est bafouée là-bas, leur humanité qui est méprisée », se désole la psychologue.
Atteintes de stress post-traumatiques, presque toutes les pensionnaires se sont vues prescrire des antidépresseurs. Des traitements qui donnent à certaines un air hébété. « Notre stratégie, c’est de les garder actives tout au long de la journée, assure Eden Ayele. Plus elles sont occupées, moins leurs vieux démons viennent les perturber. »
Après l’atelier de couture du matin pourtant, une nouvelle arrivante fond en larmes. Une crise d’angoisse, puis une autre. Des souvenirs qui refont surface. Une envie soudaine de quitter le foyer. Habituée à ces sorties de piste, l’équipe gère avec calme. La jeune femme est raisonnée. Elle assistera à la thérapie de groupe de l’après-midi consacrée aux différentes formes de réussite professionnelle.
Un salon de coiffure, un café ou le trottoir
« Aujourd’hui est mieux qu’hier, demain sera mieux qu’aujourd’hui », répète-t-on en cœur, dans une salle où se déroulent d’habitude des sessions de musicothérapie. Jeux d’équipes, pièces de théâtre improvisées… Tout est destiné à renforcer la confiance en soi et les sortir de l’isolement. « On travaille sur l’estime de soi, explique Eden Ayele. On leur fait bien comprendre qu’elles n’ont pas à se sentir coupable de leur situation, qu’elles sont en réalité les victimes. » … suite de l'article sur senegaalnet.com
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

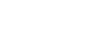

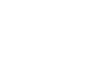

Commentaires