La Côte d’Ivoire encore loin du ``zéro grossesse`` à l’école

Depuis 2013, l’éducation nationale a fait de la lutte contre les grossesses précoces l’une de ses priorités, mais on dénombre encore autour de 3 700 cas chaque année.
Une ambiance de récréation envahit la cour du docteur Yao ce matin. Les classes de troisième de Niakara, petite ville du nord de la Côte d’Ivoire, s’agitent en rangs dispersés avant la visite médicale mensuelle. Parmi les collégiennes, deux ont leur bébé sur le dos. Salimata*, 18 ans, est venue contrôler la santé de son petit garçon d’un an. « Je suis tombée enceinte avec un homme de 27 ans alors que j’en avais 16. Lui ne vit pas ici. Quand ma mère est absente, j’emmène mon bébé en classe avec moi », explique-t-elle.
Devant ses amies, Salimata rit et relativise : « Ma mère m’a eue jeune aussi, c’est banal ici. » Si banal que les Ivoiriens ont inventé une expression simple et parlante pour désigner les grossesses précoces : « C’est bébé qui a fait bébé. » Pourtant, les derniers mois de grossesse de Salimata n’ont pas été faciles : « Une fois que mon ventre était sorti, tout le monde m’insultait, les garçons, les filles… Je n’avais plus beaucoup d’amis. » Puis vint la pression familiale : « Mon père m’a dit que si je ratais un seul examen, mes études étaient terminées. »
A ses côtés, l’une de ses copines a le ventre gonflé. Elle n’est pas enceinte mais vient de perdre son enfant après sept mois de grossesse. L’ex-futur papa s’est volatilisé depuis. « A Niakara comme dans de nombreuses petites villes ivoiriennes, les filles sont livrées à elles-mêmes, observe un professeur du lycée de la ville. Elles viennent des villages environnants et vivent à plusieurs dans des taudis. Les parents les confient à un tuteur qui ne s’en occupe presque pas. Alors parfois, elles acceptent les propositions d’un couturier, d’un garagiste ou d’un agriculteur du coin contre un repas ou un peu d’argent. »
Selon la Direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire (DMOSS), en 2017, 56,8 % des géniteurs étaient des travailleurs informels et 40 % étaient des élèves. La même année, l’éducation nationale a pointé une autre cause : les NST, pour « notes sexuellement transmissibles ». Un chantage sexuel à la bonne note qui est aujourd’hui sévèrement réprimé. La ministre de l’éducation, Kandia Camara, avait alors menacé de radier les professeurs et éducateurs coupables. Aujourd’hui, entre 2 % et 4 % des grossesses précoces seraient dues à un professeur ou un éducateur, soit entre 70 et 140 cas chaque année.
Des viols impunis
Au premier trimestre, 45 grossesses d’élèves (dont 28 mineures) ont été enregistrées dans le département de Niakara, qui compte un peu plus de 3 000 élèves dans le secondaire, selon le docteur Yao, médecin au service scolaire et universitaire de la ville. Soit une seule grossesse de moins qu’au premier trimestre 2018-2019. Depuis le lancement de la campagne « Zéro grossesse à l’école », en 2013, l’éducation nationale recense rigoureusement les cas précoces. Depuis cette date, les chiffres avoisinent les 3 700 grossesses de mineures à l’école par an « et ils seront sensiblement les mêmes en 2018-2019 », indique le docteur Sandoko N’Fa, sous-directeur à la DMOSS.
En priorité, le ministère dit avoir accentué la sensibilisation des élèves et des familles. Des préservatifs et des pilules du lendemain ont été mis à la disposition des élèves, des ateliers sur la santé sexuelle et reproductive ont été organisés. « C’est un problème multifactoriel, pose Sandoko N’Fa. Il y a la précarité mais aussi la culture. Dans certaines zones du nord par exemple, la fille doit rapidement donner signe de fécondité pour rassurer la famille. Nous devons absolument faire évoluer ces mentalités, convaincre les parents que la place d’une jeune fille est à l’école. Mais ça prend du temps. »
Dans son cabinet, le docteur Yao retire plusieurs classeurs poussiéreux de l’armoire. Il y a conservé tous les chiffres, tous les certificats, toutes les histoires. « Ici, c’est une fille de 11 ans, elle est tombée enceinte avec un agriculteur de 33 ans. Elle, c’est une élève de 15 ans, c’était avec un homme de passage dont on ne connaît pas l’âge… », énumère-t-il.
Lorsqu’un viol est dénoncé, l’homme en question disparaît ou s’en sort la plupart du temps. « Tout est réglé à l’amiable. Dès qu’on parle de prison, le père de famille se bloque, il ne veut pas faire de palabres avec quelqu’un de la ville ou de la même ethnie, alors il préfère demander de l’argent et l’histoire est réglée », développe le médecin. Et même si la loi condamne les fautifs de six mois à quinze ans de prison en fonction de la gravité des faits, « elle n’est pas appliquée », observe Didier Konan, responsable de l’ONG abidjanaise Cœur pour la mère et pour l’enfant : « Les mesures pour sanctionner et poursuivre les coupables ne sont pas prises. Alors ils continuent. »
« Je voulais avorter »
Pour éviter ces situations, le docteur Yao éduque et conseille les jeunes femmes sur les moyens de contraception. Mais peu sautent le pas. « Se protéger, c’est dire aux hommes que tu te livres, que tu es ouverte. Chez nous, avec la religion, ça ne passe pas », explique Salimata, qui réfléchit à se faire poser discrètement un implant contraceptif dans le bras. Mariam*, jeune mère du nord arrivée récemment à Abidjan, est déterminée : « Au bout de cinq mois, je voulais avorter [clandestinement], mais cela coûte très cher, plus de 500 euros. Mon père était en colère, on ne se parle plus. Maintenant, j’ai un implant, je ne veux plus revivre tout ça avant d’avoir une bonne situation. »
La plupart des grossesses et des mariages précoces entraînent la déscolarisation des jeunes filles. Bien que l’école soit obligatoire jusqu’à 16 ans, seule la moitié des filles inscrites finissent le collège, et un quart le lycée. Le ministère dit vouloir davantage d’internats pour les sécuriser et mise sur la construction de collèges de proximité, plus près des villages, pour les scolariser près de chez leurs parents et ainsi maintenir leurs repères. Dans le département de Niakara, un collège flambant neuf a ouvert ses portes en septembre dans la localité excentrée de Badikaha.
A Niakara, il n’y a ni internat, ni foyer, ni subvention aux ONG spécialisées. Alors Julie Koné s’est débrouillée toute seule. Cette salariée dans une multinationale ivoirienne a réuni ses économies et trouvé quelques partenaires pour financer le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d’Ivoire (CEFCI), son ONG. Depuis trois ans, la structure suit 40 élèves de la ville, leur offre un cadre de travail confortable et les forme individuellement dans leur éducation sexuelle. « C’est une sorte de pépinière de filles, des ambassadrices de la non-violence en milieu scolaire, des modèles à qui les autres voudront ressembler, développe Julie Koné. On est très exigeantes avec elles, elles doivent être assidues, ponctuelles, studieuses et aborder ces sujets avec leurs copines. »
Et ça paye : ces jeunes filles issues de milieux défavorisés sont aujourd’hui dans le top 60 des meilleurs élèves de la ville et ne sont jamais tombées enceintes. « Ce n’est pas la faute des jeunes filles », estime la responsable du CEFCI, qui aimerait ouvrir un foyer pour toutes : « Leur environnement est propice à ce genre de problèmes, elles ne vivent pas en sécurité et nous sommes tous responsables. Elles ont tout simplement besoin qu’on s’intéresse à elles, qu’on croie en elles. »
Source: lemonde.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

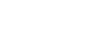

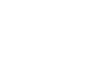

Commentaires