Nobukho Nqaba : « Je choisis les matériaux pour leur signification sociale »

Pour la photographe et plasticienne sud-africaine Nobukho Nqaba, l'art est un canal d'échange social. Elle s'est confiée au « Point Afrique ».
Sa marque de fabrique, c'est avant tout l'utilisation des sacs de filet de plastique made in China aux multiples appellations en fonction des lieux – sac Tati, sac Barbès, Ghana Must Go – qu'elle réinvente à souhait, en tant que décor, vêtements ou couvertures, dans son travail, qu'il s'agisse d'installations ou de photographies dans lesquelles elle se met en scène. L'artiste Nobukho Nqaba aime jouer avec des symboles simples et parlants. Son œuvre relate son vécu et explore son héritage ainsi que celui d'une partie de la population sud-africaine. Elle reflète une histoire personnelle faite d'arrachement et de deuil traversée par la grande histoire de son pays marquée par l'exode rural, la précarité de la classe ouvrière. Artiste reconnue, Nobukho Nqaba a déjà exposé en France, en Suisse, en Angleterre, en Italie, mais aussi au Brésil, au Nigeria et naturellement dans son pays natal. Pour Le Point Afrique, elle a pris le temps de répondre à nos questions sur son œuvre.
Comment décririez-vous votre travail ?
Je dirais qu'il est performatif. Mis en scène, il aide à partager mon histoire avec le public.
Quel type de matériaux utilisez-vous et pourquoi ?
Au début, j'utilisais des « China Bags », sacs en filet de plastique fabriqués en Chine. En Afrique du Sud, et dans le reste du monde, ils portent différents noms. Tous ces noms révèlent quelque chose au sujet des personnes qui les possèdent. Ils évoquent le voyage, le mouvement, la migration, l'altérité. J'ai récemment commencé à utiliser des couvertures grises et des bleus de travail.
Les couvertures grises sont souvent utilisées dans le pays dans des situations d'urgences comme des incendies ou des inondations, mais également auprès des personnes sans domicile fixe. Les bleus de travail, eux, sont associés à la classe ouvrière. Ils sont portés par des personnes qui ont des petits boulots mal payés, dans la construction, le jardinage, dans des fermes, l'entretien des rues…
Les personnes qui les portent sont de ma communauté. Elles me rappellent d'où je viens, c'est-à-dire de Butterworth où je suis née, dans la province du Cap-Oriental. C'est une région rurale que mon père a quitté pour travailler dans les mines à Johannesburg avant de retourner y vivre. Quant à ma mère, c'est dans des fermes qu'elle était employée, à Graboux, une région située hors de la ville du Cap.
J'ai donc choisi ces matériaux parce qu'ils ont une signification, qu'ils me rappellent mon enfance et mes expériences en tant qu'individu ayant grandi dans une famille à la situation économique précaire. En somme, je choisis les matériaux pour leur signification sociale.
« Le China Bag est ma maison » est le nom d'une de vos séries photos. Pourquoi ce titre ?
Ce sac est le symbole mondial de la migration. Quand je quittais les régions rurales pour me déplacer dans le pays avec ma famille, on en utilisait. Il ne coûte pas cher et presque tout le monde a un lien avec. Cet objet contient des effets personnels et il représente donc un foyer qui n'est jamais permanent mais toujours en transit, car ceux qui le portent cherchent une herbe plus verte ailleurs.
La migration, toujours un sujet d'actualité pour vous ? Quelle est la situation actuelle en Afrique du Sud ?
Oui, la migration est encore d'actualité. Beaucoup de personnes quittent la campagne pour s'installer dans des villes parce que c'est là que se trouvent les opportunités. Quand on s'établit en ville, on fait aussi face à de nombreux défis. On y est par exemple qualifiés de réfugiés alors même qu'on est du pays.
Vous arrive-t-il de retourner dans ces lieux où vous avez vécu ? Pourquoi ?
Oui, j'y vais toujours. Je crois que j'ai laissé une partie de moi dans chacun de ces endroits. Pour trouver un sens à ma vie actuellement, je sens que je dois m'y reconnecter. Il s'agit pour moi de me ressourcer. De fait, souvent, quand je retourne en ville après ces séjours, je me sens régénérée et prête à relever les prochains défis. Sans oublier que dans ma culture – je suis Xhosa –, on considère que nos racines se trouvent là où nos ancêtres sont enterrés et les miens reposent dans la province du Cap-Oriental. Il est donc important pour moi d'y revenir de temps en temps.
Ndiyayekelela (qui signifie lâcher prise en xhosa, NDLR) est une série cathartique que vous avez décidé de faire pour vous aider à surmonter le décès de votre père. Comment avez-vous abordé ce travail ? Comment le public dans le monde en général et en Afrique du Sud en particulier a-t-il réagi ?
C'était vraiment difficile de me lancer. J'avais le cœur lourd. Malgré tout, je savais que pour arriver à me libérer, il me fallait exprimer mes émotions à travers mon travail. J'ai dû faire appel à mon subconscient et me mettre en scène devant mon appareil en studio en utilisant des bleus de travail et des couvertures pour représenter mon père.
Sinon, la série a parlé au public, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs. Beaucoup de personnes m'ont fait part de leurs expériences face à la perte et à la façon dont elles l'ont gérée. Après avoir vu ce travail, d'autres ont été encouragées à affronter ce qu'elles ressentaient.
Vous enseignez également la photographie…
En effet, j'enseigne depuis 2014 au Peter Clarke Art Center. Récemment, j'ai commencé à travailler au Red and Yellow Creative School of Business. Je crois en l'art qui permet des discussions nécessaires autour d'enjeux sociaux. Je suis convaincue que l'éducation artistique est primordiale et doit être centrale. Elle doit faciliter les conversations qui permettront, espérons-le, d'amener du changement dans la société. J'adore enseigner, car je peux jouer un rôle auprès de la nouvelle génération.
Quelles sont vos autres sources d'inspirations ?
Je suis inspirée par les petites choses du quotidien que les gens prennent souvent pour acquises comme prendre le train ou écouter les gens parler et se raconter leurs histoires. J'aime beaucoup observer les gens interagir dans des espaces publics et m'intéresser aux objets et espaces qui comptent le plus pour eux.
Sinon, je suis également très inspirée par la scène actuelle en Afrique du Sud. Elle est vraiment passionnante. Les artistes n'ont pas peur de parler des maux de la société. Ils montent des collectifs et créent leurs propres espaces pour montrer leur travail sans avoir à dépendre des galeries. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais nos artistes sont déterminés et pleins d'énergie. Je pense à des espaces comme Bkhz.art à Johannesburg ou encore au studio où je travaille au Cap. Ce sont des lieux adaptés aux artistes émergents, car ils fonctionnent comme des communautés d'artistes. Et des personnes extérieures y viennent pour voir les œuvres. Pour ce qui est des artistes qui m'inspirent, je citerai Thandiwe Msebenzi, Rory Emmett, Nicole Clare Fraser, Igshaan Adams, Sitaara Stodel et Bulumko Mbete.
Sur quel projet travaillez-vous actuellement ?
Auparavant, je laissais les choses se faire en essayant de ne pas trop planifier, de crainte de déceptions. Actuellement, j'ai comme projet de me lancer dans un Master des Beaux-Arts. Je prévois aussi d'aller en Europe pour découvrir un environnement différent. Après cela, j'envisage bien sûr de revenir en Afrique du Sud, besoin de ressourcement oblige.
Source: lepoint.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Agenda
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

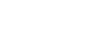




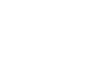

Commentaires