Safy Faye, première femme sénégalaise et africaine cinéaste : «Je ne montre que ce qui est positif»

A elle seule, Safi Faye incarne le travail de toute une génération de précurseurs du cinéma sur le continent. Enseignante, elle abandonne les classes après le premier Festival mondial des arts nègres en 1966. C’est là que son chemin croise celui de Jean Rouch qui lui donne un rôle dans son film «Petit à petit». Ensuite, direction la Sorbonne où elle suit des cours d’ethnologie, parallèlement à des études de cinéma. Ses films qui abordent des thèmes de société parlent de la condition féminine, mais surtout des maux de la paysannerie sénégalaise dans les années 1970. Son dernier film, «Mossane», arrive à Cannes après une bataille juridique de près de 7 ans. Figure emblématique du cinéma africain, Safi Faye était l’invitée d’honneur du 4e Festival international de films documentaires de Saint-Louis.
Depuis que Mossane est sorti en 1996, vous n’avez pas fait d’autres films. Pourquoi ce long silence ?
Parce que Mossane a été un film écrit et fini 15 ans après. J’ai mis 15 ans pour l’écrire. J’ai dû le réécrire 7 ou 8 fois, parfaire tout le temps et ensuite chercher tous les financements. Je les ai trouvés. Ensuite, tout le monde dit que c’est une légende, alors que c’est moi qui ai tout inventé. Pour arriver à ce stade d’invention de nouvelles images poétiques, j’ai épuisé tout ce que j’avais comme créativité. Et je ne suis pas quelqu’une qui puisse faire des films d’adaptation d’un livre ou d’une œuvre de quelqu’un d’autre. Et c’était tellement long, dur et dépressif. Je n’ai plus envie de souffrir, parce que Mossane a été bloqué pendant sept ans en justice. Les producteurs français avaient volé les droits. Cette douleur m’a fait prendre conscience que je n’ai plus de plaisir. Jusqu’à Mossane, tout ce que je faisais, c’était avec plaisir. Et pour moi, le plaisir va avec la création. Et dès l’instant que j’ai souffert, que j’ai été malade, que ma santé a été remise en question, j’ai peur de me lancer encore dans des grandes œuvres. Et j’estime aussi que vu toutes les critiques positives sur Mossane comme œuvre, ce serait aléatoire pour moi de réussir une œuvre comme celle-là. Mais je n’ai pas arrêté de faire des films, parce que je suis en train d’ordonner et de mettre à jour toutes mes archives personnelles. Le fait d’avoir été institutrice m’a donné l’opportunité de ne jamais jeter un bout de papier. Depuis que je me connais, les photos pendant que j’allais à l’école, au lycée ou que j’enseignais à l’école normale, j’ai tout archivé. Et pendant le Festival mondial des arts nègres, j’ai été détachée de l’enseignement pour recevoir tous les intellectuels africanistes que Senghor avait invités pour ce festival. Donc, j’ai des tonnes de documents que je suis en train d’ordonner. C’est un travail très difficile, mais j’aime la recherche. Je prépare un film de 45 minutes sur moi, parce que je n’aimerais pas qu’on fasse un film sur moi après ma mort. Je laisserai ce dernier document avant de mourir. Je ne filme pas, mais dans ma tête, un film est en train de mûrir.
Vous pensez le tourner quand ?
Moi, jamais je ne donne de date. Pour moi, à part Hollywood, aucun cinéaste n’a le droit de dire, le film arrivera à telle date. Je le ferai à mon rythme qui est un peu plus lent qu’à mes débuts. Je n’ai pas de contraintes, mais c’est beaucoup de travail. Les Américains qui ont des fondations de conservation savent que j’ai une collection de documents, d’archives personnelles qu’aucun autre n’a. Et donc là, ils viennent de travailler sur les archives de Ousmane Sembène. Ils sont allés partout dans le monde pour y accéder. Or moi, j’ai tout.
Que s’est-il passé pour que ça prenne autant de temps entre le tournage de Mossane et la sortie du film ?
Ben (Ben Diogoye Bèye, cinéaste. Ndlr) peut vous l’expliquer. Il a reçu de l’argent du Sénégal, mais pas d’ailleurs. Donc, il faut qu’il écrive encore. L’argent qu’il a reçu reste là. Mais cette écriture, s’il la soumet à la télévision allemande, il risque d’avoir un non. Alors, il faut qu’il réécrive. Avec Mossane, c’était la première fois que je me lançais dans la fiction proprement dite. Je n’avais encore fait que des docu-fictions. Dans tous mes films, c’est moitié documentaire, moitié fiction. Ce sont les Français qui ont dit oui en premier. Les Allemands ont dit non. Et il fallait réécrire et attendre les commissions qui existent peut-être une ou deux fois par an. Et si elles disent non, je réécris encore. Ensuite, il fallait que je le soumette au comité en Italie. Si vous voyez les co-financiers de mes films, c’est interminable. Et chaque fois, moi je pars sur la base que je dois concourir comme les Américains. Il faut que je gagne des concours de commission et sans favoritisme. Les gens qui lisent les projets et qui financent, c’est à la valeur du projet et de l’écriture. Donc, à chaque fois, j’ai réécris. Et ce que je peux vous dire de déterminant, c’est que pendant ce temps, je faisais des films institutionnels. Les Nations unies m’appelaient, l’Unesco m’appelait, Berlin m’appelait. Donc, je vivais à New York ou à Berlin et je continuais mon Mossane. Mais j’avais déjà la sécurité financière parce que je faisais des films de commande. Et dans ce cas, on a beaucoup de plaisir à parfaire, imaginer comment faire. Tous les pays du monde ont coproduit Mossane, la Suisse, la France, l’Italie, l’Allemagne. Là encore, les pays du nord continuent à participer au film. Parce qu’il était en 35 mm et ils sont en train de le digitaliser. Je les considère comme des financiers de mon film. Je n’ai pas encore fini avec Mossane.
Et une fois que vous avez fini ce film, il y a eu ce problème avec les Français qui ont voulu se l’accaparer?
Le cameraman, c’était celui qui avait gagné la Camera d’or avec Fassbender. Il a tourné les films des grands cinéastes et il a aimé mon écriture. Il a dit : «Safi, tu ne peux pas me payer, mais je ferai ton film.» Ce sont vraiment des choses inimaginables qui me sont arrivées. On a fait le film avec ferveur et amour. Et les Français se sont accaparés de mes droits comme s’il s’agissait d’un film de commande. Mais ce qu’ils ne savaient pas, c’est que moi, dès que j’écris un film, je vais l’inscrire à la Société des auteurs. Et cette dernière ne pardonne pas comme ça, qu’on essaye de voler des droits d’auteur. C’est respecté comme le droit des livres. Donc, comme ils tenaient bon, moi aussi. Mais j’avais derrière moi tous les coproducteurs. On est allé en justice. Et ce qu’il y a, c’est que quand ça va en justice, ça prend 7 ans. Il y a des délais, des convocations, chacun prend un avocat. Cela a été une bataille juridique pour qu’on me rende mon film. Et quand on me l’a rendu, je l’avais juste tourné, il fallait le monter. Comme par hasard, je l’avais tourné en 90 et on me l’a rendu juridiquement par le Centre national du Cinéma (Cnc) en 96. J’avais tout le monde de mon côté, mais les Français, c’étaient des voleurs. Ils sont tous morts maintenant. C’était un des fils de celui qu’on appelait Tatischef. Mais ce sont des gens qui n’ont jamais fait de films. Tu les prends comme producteurs-délégués et à la longue, tu n’existes plus nulle part. Mais moi, mon film est parlé en wolof, donc ce n’était pas eux qui l’avaient fait, c’est moi. Il a fallu que la justice s’en mêle et me rende tous mes droits. Et Abdou Diouf s’est beaucoup battu. Le Sénégal m’a beaucoup soutenue.
Le Sénégal vous a donné un soutien financier ?
Oui, ils m’ont donné vraiment beaucoup d’argent. Et c’était la première fois au Sénégal qu’on payait des Sénégalais comme on paie les Européens. Tous les acteurs ont été payés aux normes européennes. C’est pour ça qu’ils me demandent tous quand est-ce que je vais refaire un film. Mais j’avais l’argent pour ça. L’argent que j’avais reçu du Sénégal devait rester au Sénégal.
Abdou Diouf vous avait donné combien ?
Je ne vais pas le dire. J’étais dans tous les journaux et si vous regardez, c’était écrit. Ça a été géré et distribué. J’avais déjà choisi des acteurs, des régisseurs etc. Et tous voulaient des avances. Ça m’a fait rigoler. Un disait : je n’ai pas payé mon loyer, je risque d’être expulsé. Or, je sais que c’est ça le montant de mon cachet, et il fallait avancer cet argent. Un autre arrivait et te disait, je ne vais pas pouvoir, j’ai perdu mon dentier. Et il fallait donner l’argent pour le dentier. C’était un film dans un autre film, mais j’étais contente de les faire travailler et de les payer comme les travailleurs européens.
Et avec ce film, vous êtes allée à Cannes ?
Voilà. Et surprise, Cannes ne prend que le film de l’année, fait dans l’année. Si la fille avait 13 ans en 90, en 96, elle avait presque 20. C’était la fille d’un grand griot, un chroniqueur en wolof de la Radio diffusion sénégalaise (Rts). Et pour une fois, Cannes a dit : on n’a jamais vu un chef-d’œuvre comme ça et ils l’ont sélectionné. Personne n’en revenait. Mais en effet, c’est l’année où le film est fini qui est prise en considération. Et le Sénégal était fier. Cannes, ce n’est pas seulement le plus grand festival du monde. Et on a vu le drapeau du Sénégal flotter parmi tous les drapeaux du monde. C’était une fierté pour Abdou Diouf. Il a convoyé tout le monde à Cannes. J’ai oublié ma douleur et ma peine. Parce que j’étais malade, maigre et tout. Et le succès est arrivé. Mais le succès n’est pas arrivé là. Il est arrivé depuis que j’ai commencé à filmer. Parce que je suis quelqu’une qui aime travailler en écriture et en imagination. J’ai fait la plus grande école de cinéma. A Louis Lumière, on t’apprend tout. Moi, j’ai fait cinéma et photographie. Pratiquement, toutes les photos du film, c’est moi qui les ai faites pendant la répétition.
Et aller à Cannes, c’était une revanche sur le destin ?
Non, pas du tout. Pratiquement, tous mes autres films sont allés à Cannes. Fadial est le premier film africain sélectionné à Cannes. Lettre paysanne est allé à Cannes, mais pas à Cannes officiel. Au moment de Lettre paysanne, je l’ai soumis à la quinzaine de réalisateurs, ils ne l’ont pas pris. Mais en ce moment-là, les parties politiques, les communistes, les socialistes, parallèlement, faisaient aussi leur festival de Cannes et donc moi je suis allée dans la section communiste, donc du journal L’Humanité. Pour eux, je suis allée à Cannes et en ce moment, comme il y avait beaucoup de communistes allemands, c’est eux qui ont répercuté mon film dans le monde entier. Et on a dit une Africaine a fait son premier long métrage, parce qu’aucune Africaine n’avait osé le faire. Mais tous mes films sont allés à Cannes. C’est simplement que Mossane, avec tous les déboires et les années passant, a été sélectionné et montré dans la sélection officielle. Il y avait tout le monde, les Ben Diogaye Bèye, les Djibril Diop Mambéty, tous ceux que j’ai vus dans le film (Notre Afrique sur seine, film d’école des étudiants du Master Rdc de l’Ugb) et qui sont partis, qui sont morts. Mais il faut dire qu’ils étaient beaucoup plus âgés que moi, ils avaient l’âge de ma mère. Ils sont nés dans les années 20, 23, sauf Djibril. Djibril Diop, je me rappelle, quand je montais les marches, il a enlevé son écharpe et il a couvert le tapis rouge de son écharpe de bas en haut. C’est pour cela que j’étais très affectée après le film. Je n’ai pas dormi de la nuit.
A la sénégalaise ?
Oui, et je marchais dessus. Quand tous ces souvenirs ressurgissent, on est un être humain, on est sensible. Mais le cinéaste est quelqu’un d’égoïste comme toute personne qui crée. Mais aussi d’une sensibilité incroyable. Contrairement à ceux qui disent Safy a toujours dit non, oui j’ai toujours dit non, parce que je voulais assumer de façon responsable mon rôle d’intellectuelle, de cinéaste, d’ethnologue, mon rôle de mère, et là actuellement, j’assume mon rôle de grand-mère. Mais je n’ai plus d’obligations parce que mon travail a été reconnu. Je n’ai plus d’obligation pour créer.
Comment êtes-vous passée d’enseignante à cinéaste ?
J’ai été enseignante. On m’a détachée de l’enseignement pendant le Festival des arts nègres. A ce moment-là, j’étais une jeune fille remarquée par tout le monde. Et puis, j’étais à l’école du Plateau où on était deux Africaines, tout le reste était des Européens. Ensuite, c’était l’Ecole normale, parce qu’on commençait à remplacer les enseignants européens, français surtout. Et la première promotion, c’était les Mariama Bâ, et nous c’est la deuxième promotion de l’Ecole normale. Après le Festival mondial des arts nègres, il y a eu un déclic. Je me suis rendu compte que je ne connaissais rien de l’Afrique, à part les poèmes de Senghor qui disaient qu’on est venu d’Egypte, qui parlaient de l’homme primitif. Or, cette conférence m’a fait côtoyer tous les chercheurs africanistes. Ils étaient tous Européens et parlaient d’une Afrique que je n’ai pas apprise à l’école. J’ai appris à l’école comme une française l’histoire de la France. Au bout de 7 ans, j’ai laissé tomber l’enseignement avec l’accord de mes parents. J’ai dit je vais en France apprendre l’africanité. Là où on l’apprenait, c’était dans les universités et la plus connue, c’était la Sorbonne. Donc je suis arrivée et je me suis inscrite en ethnologie, anthropologie et tout ce qui est africain. Parce que tout est là-bas et rien ici. Même l’Institut fondamental d’Afrique noire (Ifan), c’est des Français qui venaient pour nous apprendre notre civilisation. Et au moment où je suis arrivée à la Sorbonne, comme par hasard, il y avait une section cinéma, avec des Africanistes comme Jean Rouch qui était tout pour moi, mon ami, mon frère, et que j’ai connu au Festival des arts nègres, comme tant d’autres. Après un cours d’ethnologie, il montrait toujours un film africain qu’il a fait dans les années 40. Il y avait une rivalité entre lui et Sembène, parce que ce dernier lui disait tout le temps, tu nous filmes comme des sauvages. J’ai vécu toute cette période. Et le fait de voir que l’anthropologie pouvait être utilisée et est plus facile à utiliser en montrant les images, je suis allée m’inscrire à Louis Lumière. J’étais à la Sorbonne pour l’ethnologie et j’allais parallèlement à Louis Lumière, où j’étais la première Africaine noire à y aller. J’ai appris le cinéma là-bas. Et avec mon audace, dès qu’on a fini le film collectif, j’ai aussitôt fait mon propre film avec mon propre argent. C’est le film qui s’appelait La passante. Parce que j’étais en tournée avec des gens qui étaient des professionnels du cinéma. Le cameraman était un Américain qui était de passage. C’est comme cela que j’ai commencé. Je faisais beaucoup de choses en même temps, parce que j’avais le temps, la détermination et la jeunesse, et je m’amusais comme une princesse.
Mais vous êtes restée très attachée à votre terroir de naissance, le pays sérère…
Quand je suis venue en France d’abord, mes parents sont venus voir si mes conditions de vie étaient positives. Sinon, mon père m’aurait ramenée. Après la Mecque, ils passaient à Paris pour voir. Parce que c’était des parents aimants, possessifs, mais qui avaient confiance en moi, et ils se disaient, moi vivant à l’étranger, tous leurs enfants sortiraient. Donc, j’avais déjà la mission de conseiller mes sœurs : «Ayez le Bac avec mention ! Si vous avez le Bac avec mention, vous aurez une bourse.» Le cinéma, à cette période-là, il fallait vivre en Europe pour pouvoir en faire. Il n’y avait rien, la télévision c’était des images de la France qu’on nous montrait. Mais chaque année, je suis ici au Sénégal.
Mais personne n’entend parler de vous quand vous êtes là…
Personne n’entend parler de moi, parce que je me refugie dans mon village. Pour que j’aie des images comme cela, il faut que je me refugie dans ma communauté pour que tout le monde soit prêt à être filmé. Il faut que je sois dans ma communauté. Je n’aime pas le dire souvent, mais ma famille fait partie de la chefferie, des bâtisseurs du village, aussi bien du côté de mon père à Fadial que de ma mère à Sessenne, près de Kaolack. C’est eux qui ont bâti ce village et ils sont derrière moi à me soutenir. Tout le monde connaît le pays sérère, tout le monde connaît le pays casamançais, parce que j’ai travaillé là-bas et moi je ne montre que ce qui est positif. Je ne montre jamais ce qui est négatif. Cela ne m’intéresse pas, je dis aux gens débrouillez-vous pour que ça soit positif au Sénégal.
Et ça vous semblait important de faire connaître cette parole des paysans, ces mots des paysans ?
Et j’étais la première à oser l’aborder. Parce que tous sont devenus des citadins. Et tous tournent leurs films, pas dans leur village, mais pratiquement à Dakar. Moi j’ai mon village, j’ai tout ancré sur mon village. Et je sais que quand je tourne, Sembène vient, tout le monde vient voir dans mon village. On est tous né de la terre, on est tous des paysans. Je suis la première à avoir donné la parole aux paysans. Parlez, videz votre sac ! Parce que j’ai trouvé l’agronome, l’économiste, je l’ai trouvé, n’étant pas allé à l’école, mais ils analysaient la situation économique aussi bien que René Dumont qui était le plus grand agronome d’Europe. Il fallait que je le montre. C’est leur parole.
Aujourd’hui, vous avez fait 43 ans de cinéma. Qu’est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes ?
Je suis contente de vivre leur siècle. Parce que c’est celui de l’informatique. Nous, notre siècle, on touchait la pellicule. Tout était manuel, c’était de gros matériels. C’est bien de regarder ces plans, comme à travers la lumière du jour. Même s’il y a la machine de montage. Ils ont la chance d’être dans le numérique, parce que nous actuellement on est en train de digitaliser nos films. On les met en numérique. Tout ce que j’ai à leur dire, c’est qu’ils ne seront jamais riches avec leurs films. Parce que tout ce qui restera à l’auteur d’un film, c’est les droits d’auteur si le film est inscrit dans les sociétés de droits d’auteur. Si je meurs, tout retournera à mes enfants, mes petits-enfants. Il y a des lois, des règles et ces règles, il faut qu’ils les imposent pour que l’Afrique ait ses sociétés de droits d’auteur. Quand Youssou Ndour chante, il reçoit des droits d’auteur. Le cinéma, ça devrait être la même chose. Partout dans le monde, même si ses chansons passent au Japon, il reçoit des droits d’auteur, c’est comme cela que doit être le cinéma. Ensuite, il faut essayer de ne pas faire n’importe quoi, mais de faire ce qu’ils ont envie de faire : une histoire avec un début et une fin. C’est leur imagination qui doit les guider. C’est pour cela que je ne fais pas de films d’adaptation. Parce que je sais que j’ai la possibilité et les moyens d’écrire. Et ne jamais se décourager parce qu’un échec, c’est provisoire. Si on persévère, on arrive à son but. Et le faire avec plaisir. Ne pas se dire que ça pourrait être vu à la télé. Non, on ne peut pas calculer son film. C’est aléatoire. Le succès arrive, mais avant, il y a plein d’échecs. Il faut avoir le courage de les assumer et de faire son autocritique et essayer d’inventer de nouvelles images. Maintenant, tout le monde a son smartphone. En France, on peut faire un film avec un smartphone et la télé le montre. Et il faut qu’on vous forme mieux. Pas en une semaine, mais qu’on fasse venir des professionnels. Moi, je ne suis pas une professionnelle. J’ai appris et j’utilise mon savoir pour mes films. Mais je ne fais pas de leçons de cinéma. Le cinéma n’est pas né en Afrique, il faut le dire. Et les professionnels viennent pour que l’Afrique trouve sa place dans la mondialisation. C’est tout ce que j’ai à leur dire. Et aussi que c’est difficile. Parfois ça frôle le masochisme. Ma mère me disait, comment tu peux souffrir comme ça et continuer. Mais c’est tellement obsédant un film que dès qu’on l’a fini et donné au public, on pense à un autre. Moi, ça a toujours été comme ça. Je n’ai pas fini. Je travaille sur un autre film qui sera encore plus difficile. Je suis quelqu’une qu’on n’a jamais vu. J’ai toujours refusé les photos. Je viens, je donne mon film et je dis aux gens, essayez de ne pas me filmer, de ne pas me photographier. Ce n’est pas que je vivais cachée, mais c’est mon éducation. Je suis contente d’être Sérère. Je ne suis pas une Dakaroise, je viens du village. Je viens des régions et des communautés où la fierté de l’individu est sacrée. Ne jamais faillir, mais toujours essayer d’être premier ! Mais il faut du temps pour ça.
Et le cinéma africain, vous pensez qu’il est à la place où il devrait être ?
Non, je ne pense pas, parce que les films qui vont à Cannes n’ont pas la répercussion qu’on attendait. Si mes films d’il y a 40 ans continuent encore à être demandés, c’est peut-être parce que j’ai touché un monde qui originellement est africain, mais que les citadins n’ont jamais reconnu comme valeur, c’est-à-dire la paysannerie. C’est pour ça que mes films sont intemporels. Moi, j’ai parlé de l’émigration en 1975. Et pendant ce temps, les paysans se déplaçaient du village à Dakar, du village à Conakry, du village à Bamako. Et ils retournaient au village pendant la saison des pluies. Actuellement, ils ne repartent plus au village. Ils viennent grossir les bidonvilles. Ce qui est pire, c’est qu’ils vont mourir en Méditerranée. On a beau les arrêter, ils ne veulent pas. Quand la France a 3 millions de chômeurs, c’est de l’inconscience que de prendre sa femme et ses enfants pour dire qu’on traverse pour aller en Italie où il y a 5 millions de chômeurs qui sont nés là-bas. Pourquoi cette obsession ? Pourquoi tous ces enfants africains morts dans le désert et depuis les années, les parents ne savent pas ce qu’ils sont devenus parce qu’ils sont morts ? Enterrés sans sépulture ni rien. Maintenant, on peut travailler sur l’ordinateur et avec le Japonais. On peut tout faire en restant chez soi. C’est ça l’ère que j’ai vécue et que je ne pensais pas qu’elle existerait. J’ai vécu la paix, la sérénité, pas la mondialisation. Et je suis contente de vivre ce siècle que mon père n’a pas vécu. On peut rester ici et faire des affaires, au lieu de s’aventurer dans le désert et laisser ses parents mourir dans l’ignorance. Et ces parents qui s’endettent, pourquoi ? Il n’y a plus rien en Europe.
Mais qui doit arrêter ce flux ?
Mais c’est les parents. Puisque ce sont eux qui cotisent. C’est facile maintenant de comprendre l’histoire. Ce flux en Libye, ce sont les parents qui ont payé pour que les enfants aillent en Libye. On le comprend d’autant mieux qu’on leur dit de payer pour le retour. Donc, ce sont les parents. C’est une question d’éducation, mais aussi de dignité. Faire d’un Sénégalais un esclave, c’est inadmissible. Mais l’Arabe a toujours été comme ça. Pour l’Arabe, la peau noire ne peut être qu’un esclave. Et pourquoi ? Je le domine sur tous les angles, j’ai plus de diplômes, mais pourquoi je dois me faire esclave ? Par la couleur de ma peau ? Mais eux, ils n’ont pas plus de considération que moi en France. On me considère mieux, moi Sénégalaise, que l’Arabe. C’est ça la différence. On a eu Senghor, Birago Diop. Eux tout ce qu’ils ont eu, c’est la langue arabe. Ils ont commencé à prendre leur essor grâce à leur pétrole. Mais le pétrole va finir. Ignorons-les, c’est tout !
Cette année, on célèbre le centenaire de Jean Rouch que vous connaissez bien. Que retenez-vous de lui ?
Jean Rouch m’a accompagnée depuis le Festival des arts nègres. C’est là que je l’ai connu comme beaucoup d’autres chercheurs. Il était tout pour moi. Nos liens sont tellement ambigus que sur mon film, je ne ferai que lire les lettres qu’il m’écrivait. Pour son centenaire, j’ai été surprise de le voir à côté de moi dans le catalogue du Festival du film documentaire de Saint-Louis. Rouch connaît toute ma famille. Il était tout le temps au Sénégal. Les gens de la fondation qui organisent le centenaire sont tous venus chez moi. Mais c’est l’année de Rouch. Ce n’est pas mon année. Ce qu’ils peuvent montrer de public, c’est le film. Donc, je leur laisse la responsabilité de faire l’éloge de Rouch. Moi, j’étais juste une parenthèse. Ce que je dirai de Rouch, mes liens avec Rouch seront dans mon film.
Non. Je ne veux pas en parler. Le monde entier se pose des questions. Rouch et la Sénégalaise, la Sénégalaise et Sembène. Moi, j’ai des documents de l’époque. Il n’y a que la mort qui nous a séparés.
Source : lequotidien.sn
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Agenda
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

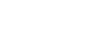




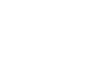

Commentaires