Kakora, mariée à 13 ans au Burkina : « Je vivais la peur au ventre, il m`enfermait pour m`attraper »

La moitié des jeunes Burkinabées sont contraintes à l’union avant leurs 18 ans et une sur dix avant ses 15 ans, selon l’Unicef.
La vie de Kakora* bascule il y a deux ans. Un jour de janvier, son père décide de la marier à l’époux polygame de sa tante. Elle n’a que 13 ans. Lui, plus de 40. « Sans rien me demander ni même m’expliquer, on me force alors à quitter le village du jour au lendemain pour aller vivre chez cet inconnu », témoigne-t-elle en langue nouni, les yeux baissés. Dans sa famille, la coutume veut que la nièce ou la petite sœur d’une femme épouse le même mari. « Nos ancêtres avaient instauré cela, pour garantir la stabilité des ménages, et si tu refuses, tu es bannie », déplore sa grand-tante, chez qui l’adolescente a trouvé refuge il y a quatre mois à Léo, dans le sud du pays.
Echange de filles entre deux familles, « rapt » pour forcer une union ou encore « sororat » – le remariage d’un veuf avec la sœur de son épouse défunte –, le mariage d’enfants a la vie dure au Burkina Faso, qui enregistre le cinquième taux le plus élevé au monde. Une fillette sur deux y est contrainte avant ses 18 ans et une sur dix avant ses 15 ans, selon les chiffres du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Et si rien n’est fait, le nombre de « filles-épouses » devrait doubler dans le monde d’ici à 2050, alerte l’agence onusienne.
« Fille maudite »
Faute d’argent pour pouvoir s’enfuir, Kakora a vécu deux ans de calvaire à Fada N’Gourma, à plus de 300 kilomètres à l’est de Tabou, son village natal. « Je vivais la peur au ventre, il m’enfermait pour m’attraper [me violer] et me frappait avec un bâton ou avec une corde si je n’obéissais pas. Ma tante aussi me battait et m’insultait parce que j’essayais de résister », confie la jeune fille qui, prise au piège et terrorisée, subit donc en silence. On lui interdit d’aller à l’école, d’avoir des amis et même de jouer. A la place, elle doit faire le ménage et s’occuper de l’enfant de sa tante avant de tomber elle-même enceinte et d’accoucher difficilement d’un bébé qui meurt à seulement quatre mois. Là, le cercle de violence aurait pu se remettre en place. Mais, endurcie par cette grossesse très prématurée et ce décès, Kakora trouve la ressource pour tenir tête. Le « refus de trop » pour sa tante et coépouse, de quinze ans son aînée, qui préfère la mettre à la porte, la transformant du même coup en « fille maudite » qui déshonore sa famille.
Des histoires comme celle de Kakora, Ablassé Koanda, enseignant au collège de Neboun, à une trentaine de kilomètres de Léo, en connaît des dizaines. A la rentrée dernière, deux élèves de cinquième ont encore disparu. Et c’est chaque fois le même scénario. « Les parents profitent des grandes vacances et, après trois ou quatre mois de mariage, il est trop tard pour intervenir », regrette-t-il. « Du jour au lendemain, les filles ne viennent plus en classe, leurs camarades nous avertissent qu’elles sont enlevées par des villageois pour être mariées, et on n’a plus de nouvelles », poursuit ce professeur de français, qui avoue avoir abandonné les recherches pour éviter de s’attirer « des problèmes ».
A la direction provinciale du ministère de la femme, de la solidarité et de la famille de la commune, les dossiers s’empilent tristement. Déjà neuf fillettes mariées de force depuis le mois de janvier, 26 en 2018, selon ses recensements. « Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg !, explique Eric Somda, qui dirige la structure. Celles-ci ont pu être retrouvées parce que les familles nous ont appelés. On estime [que] le nombre de victimes [est] quatre fois plus élevé sur le terrain. Mais il nous est difficile d’accéder aux villages et de repérer les cas qui n’ont pas été signalés. » Pour les six enquêteurs de la province de la Sissili, qui regroupe près de 200 communes et villages, la mission relève parfois de l’impossible. « On interroge les proches et les chefs coutumiers, mais on manque d’effectifs et même de moyens pour se déplacer. Souvent on arrive trop tard, les filles ont coupé leur téléphone et ont déjà disparu dans la nature », regrette le directeur, qui travaille en coopération avec la gendarmerie et la police locale.
La structure ne dispose pas non plus de lieu d’hébergement pour accueillir les victimes, reniées par leur famille une fois récupérées. « Il existe quelques familles d’accueil, mais elles sont déjà débordées, alors on se débrouille. Une collègue accepte quelquefois d’en loger une, on est devenus des travailleurs sociaux !, souligne le commissaire Boureima Ouedraogo, de la gendarmerie de Léo. Pour les autres, pas de solution, si bien que « certaines se retrouvent livrées à elles-mêmes, à la merci des hommes, et tombent parfois dans la prostitution pour survivre. »
Séquelles psychologiques
Au Burkina Faso, où l’âge légal de l’union civile est fixé à 17 ans pour les filles et où le mariage de mineurs est théoriquement passible d’un à trois ans de prison, le phénomène perdure. « Dans certains villages, cela reste une norme sociale. Dès qu’une fillette est pubère, elle doit se marier parce que les parents craignent par-dessus tout une grossesse hors mariage, considérée comme une honte. » « A cette peur s’ajoute la consolidation des liens entre familles par l’échange d’enfants », explique Eric Somda, qui tente pourtant de faire changer les mentalités par le moyen de médiations. Dans les foyers les plus modestes, la dot versée par le fiancé peut aussi être déterminante. « Quand on a déjà trop de bouches à nourrir, on préfère parfois vendre sa fille contre des bœufs et plusieurs centaines de milliers de francs CFA », précise-t-il. Pauvreté, manque d’éducation, espoir d’une vie meilleure poussent même certaines adolescentes à se résigner, voire à aspirer au mariage. Avant les désillusions…
Très vite, en effet, ces jeunes filles, isolées, la plupart du temps déscolarisées, voient leur vie menacée par les grossesses précoces et les accouchements à risque, les violences et l’exploitation domestiques. « Le plus dur, c’est quand on voit partir des élèves qui avaient des bonnes notes et un avenir prometteur, elles se retrouvent dépendantes financièrement de leur époux et sont condamnées pour le reste de leur vie », s’attriste l’enseignant Ablassé Koanda.
D’autant que, même si elles se sortent de cette situation, les séquelles psychologiques restent profondes. La grand-tante de la jeune Kakora, qui l’héberge dans une petite case en terre cuite au toit de tôle avec quatre autres orphelins, a été confrontée à ce drame psychologique. « C’était très difficile pour elle au début, se souvient-elle. Elle ne mangeait pas, ne parlait pas, elle faisait beaucoup de cauchemars et pleurait souvent. » Aujourd’hui encore, la « honte » et les souvenirs hantent l’adolescente de 15 ans. « Je ne sais pas ce que je vais faire, mon père ne veut plus de moi, ma mère me manque, et c’est trop tard pour retourner à l’école », estime celle qui rêve de devenir coiffeuse. En attendant, elle ne sait trop quoi faire, elle aide sa « tantie » à la production de soja. Une façon de sentir la liberté et de reprendre goût à la vie.
Source: lemonde.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Agenda
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

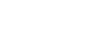




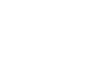

Commentaires